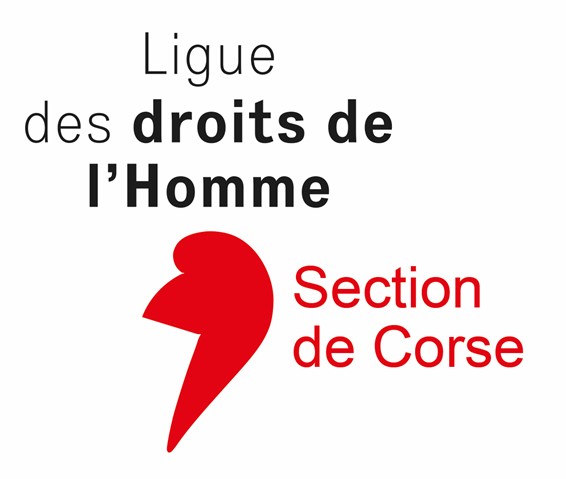Emission France Culture avec Patrick BAUDOUIN - L'offensive contre la ligue des droits de l'Homme - 28 mai 2023
De quoi la Ligue des droits de l’Homme est-elle lenom/non ?
Par Emmanuel Naquet Historien - Revue AOC - 2 mai 2023
Association
politique mais non partisane, la Ligue des droits de l’Homme, scandaleusement
attaquée ces dernières semaines par le gouvernement lui-même, n’a cessé depuis
sa création en 1898 de défendre toutes les libertés et les droits économiques
et sociaux. L’historien Emmanuel Naquet rappelle, exemples à l’appui, comment
la LDH s’est toujours mise au service d’une certaine vision de l’État de droit
et d’une République revivifiée, plus ouverte et plus juste, dans le cadre d’une
démocratie politique et sociale.
Auditionné
au Sénat le 6 avril 2023 sur l’action des forces de l’ordre lors du
rassemblement citoyen du 25 mars contre la mise en place d’une méga-bassine à
Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, manifestation finalement interdite, le
ministre de l’Intérieur est interpellé par le sénateur LR du Tarn-et-Garonne,
François Bonhomme, ému du rôle joué par la Ligue des droits de l’Homme (LDH). «
La Ligue des droits de l’Homme est financée sur fonds publics. Il faut cesser
de financer des associations qui mettent en cause gravement l’État […]. Ces
associations n’ont rien à voir avec l’État de droit, quoiqu’elles en disent »,
estime le sénateur. Ce à quoi Gérald Darmanin répond : « Effectivement, ça
mérite d’être regardé. »
Interpellée
dans la même Haute-Assemblée quelques jours plus tard, le 12 avril, à
l’occasion des questions au gouvernement, la Première ministre, Élisabeth
Borne, déclare connaître l’histoire de « cette grande association »,
jugeant que « pendant longtemps, l’histoire de l’émancipation républicaine
et celle de la LDH se sont mêlées. L’universalisme était un terreau
commun ».
Mais
l’ancienne conseillère des socialistes Lionel Jospin et Jack Lang, avant de
devenir directrice du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l’Écologie,
ajoute : « Je ne comprends plus certaines de ses positions. Cette
incompréhension […] s’est fait jour dans ses ambiguïtés face à l’islamisme
radical, et elle s’est confortée depuis quelques mois ».
En
contrepoint de ces deux proclamations, l’ancien président de la LDH, le
pénaliste Henri Leclerc précise, dans un entretien à L’Humanité du 12
avril 2023, dont la une porte une pétition de soutien à la LDH, que les
associations « sont l’expression d’un collectif » et « un fondement de la démocratie
». Deux jours plus tard, l’avocat Patrick Baudoin, ancien président de la FIDH
et responsable de la LDH depuis 2022, affirme dans Le Monde que
« notre pays […] glisse progressivement vers les régimes
illibéraux ».
On le voit,
deux séries de déclarations opposées montrent les tensions entre un exécutif
qui se veut transpartisan et réformiste, d’une part, et l’un des plus anciens
corps intermédiaires à vocation généraliste, défenseur des droits humains,
d’autre part. Quatre discours qui questionnent la nature de notre République en
particulier, et de notre démocratie en général, dans ses représentations
– à tous les sens du terme – comme dans ses pratiques. Quatre
visions au cœur des débats actuels interrogeant les légitimités et légalités
des acteurs de la polis, à associer ici aux questions des valeurs et des
principes d’organisation des sociétés. Quatre perceptions qui interrogent le
triptyque de la chose publique en France – liberté, égalité,
fraternité –, mais aussi la solidarité et la dignité, même si ce sont, en
l’occurrence, davantage la place et le rôle des libertés individuelles et
publiques qui sont en jeu.
La Ligue des
droits de l’Homme est créée en 1898, en pleine affaire Dreyfus. Les dreyfusards
réunis lors du procès Zola s’insurgent contre la condamnation pour haute
trahison d’un capitaine d’artillerie où, au-delà de la raison d’État, sa
judéité pèse. Ils entendent structurer, avant même la loi de 1901 qui autorise
les associations, un mouvement pour défendre Alfred Dreyfus. Cette fondation
s’explique donc largement par la double impasse, judiciaire et politique, dans
laquelle se trouvent les dreyfusards. Son premier manifeste condamne ainsi
« l’irrégularité du procès » et « l’innocence du
condamné ». Stigmatisant une « campagne de diffamation et de
mensonges », le texte pointe aussi l’antisémitisme qui frappe un citoyen.
Mais le
modèle d’engagement, civique, éthique et foncièrement politique, est affirmé
dans son premier manifeste qui considère que « le condamné de 1894 n’est
pas plus juif à nos yeux que tout autre, à sa place, ne serait catholique,
protestant ou philosophe », mais un « citoyen dont les droits sont
les nôtres ». L’extrapolation de la cause est claire : « Toute
personne dont la liberté serait menacée ou dont le droit serait violé est
assurée de trouver auprès [… de la LDH] aide et assistance ». Et
l’association de rappeler que «l ’intérêt de tous les citoyens est engagé
de ne jamais accepter, même sous prétexte de raison d’État, l’abandon des
formes légales qui sont la garantie d’une application prudente de nos lois
répressives. L’œuvre de la Justice n’offrirait aucune sécurité, si la
violation flagrante des droits de la défense restait sans recours ». La nature
de ces lignes fait sens : il ne s’agit pas d’une courte protestation, avec
les signataires d’une pétition, mais d’un texte fondateur.
Des libéraux
modérés en sont les initiateurs, le député et ancien ministre Yves Guyot, les
journalistes Francis de Pressensé, jaurésien, Ernest Vaughan, directeur de L’Aurore
qui vient de publier le « J’accuse… ! » et Georges Bourdon,
future cheville-ouvrière du Syndicat national des journalistes. Des politiques
également ont poussé à cette prise de position, à l’instar du sénateur radical
Arthur Ranc ou du philologue Louis Havet.
Il reste que
la jeune LDH n’est pas autorisée mais le gouvernement d’Henri Brisson la tolère
par une décision du 18 juillet 1898. En effet, pour faire le pendant aux
perquisitions dans les locaux de l’extrême-droitière Ligue des Patriotes,
dirigée par Paul Déroulède, le pouvoir de Félix Faure décide, en vertu de
l’article 291 du Code pénal et de la loi de 1834, de poursuivre, dans un
« en même temps » de 1899, la très conservatrice Ligue de la Patrie française
et la Ligue française des droits de l’Homme et du citoyen – tel est
son titre exact. La perquisition, effective le 1er mars 1899, avec saisie de
documents et de bons pour une valeur de 15 000 à 20 000 euros
actuels –, avait été anticipée : le neurophysiologiste Louis Lapicque
propose ainsi à ses collègues de fonder un journal « dont tous les
adhérents de la Ligue seraient les abonnés », mais l’association
revendique sa fonction.
Au lendemain
du lancement de la procédure par un juge d’instruction, elle annonce
« attendre avec confiance la décision qui sera prise sur les perquisitions
pratiquées à son siège ». Son comité directeur – futur comité
central et aujourd’hui comité national – considère s’être
« toujours montré respectueux de la Loi [sic] », n’avoir
« jamais fait autre chose que défendre l’idée de Justice et de
Liberté » et ne pouvoir « admettre qu’un gouvernement d’origine
républicaine lui retire le droit à la tolérance dont tant d’autres
associations jouissent à côté de lui, alors surtout que de tous côtés la
liberté d’association est réclamée ».
Ce sont son
secrétaire général – le publiciste et critique d’art Mathias
Morhardt –, son secrétaire général adjoint – Louis
Lapicque –, son trésorier – l’industriel Henri Fontaine –,
ses deux vice-présidents – le chimiste Édouard Grimaux et le
biologiste Émile Duclaux, successeur de Louis Pasteur à l’institut
éponyme – qui sont finalement poursuivis, car Ludovic Trarieux est
couvert par son immunité parlementaire. Cela permet à ce dernier, avocat, de
plaider la légitimité de la fonction de la LDH : « Qu’il existe
des sociétés de secours mutuels contre la misère, de même n’en doit-il pas
exister pour la protection de la liberté et de l’honneur ? ». Mais
Ludovic Trarieux revendique aussi la participation des anarchistes à la
dynamique : « Si des hommes […] se sont rencontrés avec
nous dans les sentiments de justice auxquels nous faisons appel, nous n’avions
point à les repousser, et nous ne pouvions, au contraire, que nous applaudir
de les voir se ranger à des idées qui sont le patrimoine moral de la
République. Nous n’avions pas à regarder qui marchait à côté de nous, mais
vers quel but nous marchions ».
En
définitive, la sanction se limite à une amende symbolique de 16 francs…Somme
toute, 1898 fait écho aux années post-1968 lorsque la LDH prenait la défense
des militants « gauchistes », et à l’actualité, alors qu’elle met
encore et toujours en avant la liberté d’expression pour les
« activistes » de « l’éco-terrorisme » (Gérald Darmanin).
Reste que
l’association ne s’appuie pas seulement sur la pétition, la souscription, la
réunion, au temps où la liberté de manifester dans la rue n’existe
pas – il faut attendre 1935. Là encore, Ludovic Trarieux est à la
manœuvre : quand, à l’occasion d’un meeting perturbé par les ligues
d’extrême-droite, Francis de Pressensé, Mathias Morhardt et Ernest Vaughan sont
arrêtés par la police, l’ancien garde des Sceaux Ludovic Trarieux leur
écrit : « En usant du droit de réunion publique pour provoquer
une manifestation imposante sur une grande question de justice et d’humanité,
vous avez agi dans la plénitude de votre droit ».
Précisément,
la Déclaration de 1789 est « la bible » des ligueurs, de 1898 à
aujourd’hui. Des formules, toujours à rappeler, résonnent en eux. Quelques
exemples : « L’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de
l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements », des « droits naturels, inaliénables et
sacrés », la « résistance à l’oppression », « le droit
[pour tous les citoyens] de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à [la] formation de la loi ». Deux articles sont à leurs
yeux essentiels : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par la loi » et « nul ne doit être
inquiété pour ses opinions », ce qui explique l’un des nombreux combats
gagnés par la LDH, la demande d’affichage de la Déclaration dans les écoles,
dès 1901, puis dans les casernes, les commissariats, les tribunaux, dès 1905.
C’est bien
sûr à partir de ce legs humaniste que la LDH élargit son horizon avant la
Seconde Guerre mondiale et cela dans tous les registres, avec une progressivité
vers des horizons inatteignables qui la met souvent en avance sur son temps,
mais qui, parfois, la place dans une culture politique partagée.
Quelques
exemples : défense des « indigènes » contre l’arbitraire, rejet
de la peine de mort, exigence de la gratuité de l’enseignement à tous les
degrés comme du maintien de la liberté de l’enseignement pour finalement
s’activer en 1984 en faveur d’un service public unifié et laïque de l’éducation
nationale, demande du droit de vote et d’éligibilité des femmes aux conseils
municipaux – puis pour tous les scrutins –, attente d’une
égalité des salaires des travailleurs des deux sexes, campagne pour la
réhabilitation des « fusillés pour l’exemple », affirmation de la
liberté des migrations et exigence de l’application du droit d’asile pour tous
les réfugiés, recherche d’une démocratie participative, loin du discours de
Bayeux du général de Gaulle et de la constitution de 1958 – elle
s’oppose en 1962 à l’élection du président au suffrage universel direct –,
condamnation des dictatures en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Amérique
latine, en Asie comme en Europe de l’Est, applaudissements à la fin des
juridictions d’exception, appel à un droit de vote pour les résidents
étrangers, à commencer par les élections municipales, et à une régularisation
des sans-papiers, lutte contre toutes les discriminations, sexistes,
homophobes, etc., revendication d’une justice environnementale…
Mais il
serait erroné de croire que la LDH se limite à des postures de vigie. Sans être
un contre-pouvoir, cette association politique mais non partisane prouve que
les droits sont politiques. Elle participe ainsi à la séparation des Églises et
de l’État, suggère des réformes fiscales comme la taxation des plus-values du
capital ou la diminution des impôts indirects, propose une révision de la
justice militaire, soutient la mise en place des assurances sociales, annonçant
la Sécurité sociale, collabore avec la défenseure des droits, la contrôleure
des lieux de privation des libertés, la CNCDH, plaide pour la solidarité et
applaudit au principe de Fraternité reconnu par le Conseil constitutionnel.
En
définitive, un inventaire à la Prévert ? Certes, les prises de position
s’égrènent sur les 125 ans de son histoire, avec des prudences – le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, poussé par la LDH, est à destination
des nations européennes et si la LDH condamne tous les arbitraires dans les
colonies, le souhait d’indépendance des peuples soumis vient plus tard (1950
pour le Vietnam et 1962 pour l’Algérie, avec une acceptation des accords
d’Évian). Mais il est des fils rouges qui sont autant de signes de pérennité et
de fidélité de la place et du rôle de la LDH face aux pouvoirs, avec quelques
moments d’égarements, lorsque la politique la saisit.
Quand la LDH pense contre elle-même
D’emblée, la
LDH s’est refusée à ne pas faire de politique. Si, aux élections municipales de
1900, elle décide de s’abstenir deux ans plus tard, l’opposition des droites
conservatrices et extrêmes au gouvernement très dreyfusard de « Défense
républicaine » l’a fait entrer dans l’arène. Il s’agit, après avoir dénoncé le
« nationalisme, cette sorte de Protée de la réaction, qui tantôt parle au nom
d’un monarque, tantôt au nom d’un César, tantôt au nom d’un agitateur vulgaire,
tantôt même au nom d’une République de parade, mais qui, sous tous ces
masques, sert avant tout la congrégation et s’inspire du Syllabus », la LDH
adresse, au second tour, un manifeste aux « électeurs républicains » en faveur
du candidat « réellement républicain ».
De même, la
« campagne laïque » de 1902-1903 qui permet à Émile Combes d’arriver au pouvoir
s’appuie sur les sections de la LDH. De même, en 1924, avec la victoire du
Cartel des gauches ou, en 1936, avec celle du Front populaire, auxquelles elle
a contribué, à sa base avec les comités antifascistes constitués au lendemain
du 6 février 1934 et à son sommet autour de figures comme Victor Basch et Émile
Kahn. Plus près de nous, en 2017 comme en 2022, l’association a appelé à faire
barrage au Rassemblement national.
Néanmoins,
trois moments peuvent-être dégagés où la LDH a pu s’écarter un temps des
droits, et d’abord au moment de l’affaire des fiches. Qu’en est-il ? Nous
sommes en octobre 1904. Un proche collaborateur du général André, le commandant
Cuignet, a mis sur pied un dispositif permettant, avant d’établir les
promotions d’officiers, de connaître, grâce aux informations transmises par le
Grand Orient, le degré de fidélité au régime républicain des candidats ;
un véritable système a donc été mis en place pour épurer l’armée. En fait, le
combisme au pouvoir, contesté au centre-droit et par des radicaux dissidents,
est le prolongement politique d’une affaire Dreyfus qui a révélé́ le caractère
globalement antirépublicain et même antidémocratique de la tête de l’Armée.
Or, il faut
un mois à la direction pour choisir entre l’éthique et la politique, à la suite
des vives critiques de dreyfusards des origines – le juriste Charles Rist,
le pasteur Louis Comte, le sociologue Célestin Bouglé et le philosophe Georges
Sorel, qui a déjà pris ses distances avec la LDH. Dans les Cahiers de la
Quinzaine, Charles Péguy sera sévère sur cette « délation » des
droits de l’Homme, tandis que des dreyfusards comme le gambettiste Joseph
Reinach, le radical Paul Guieysse, l’historien Émile Bourgeois quittent la LDH.
Alors que le
ministre de la Guerre démissionne, cette dépression permet au deuxième
président de la LDH, Francis de Pressensé, soutenu par de purs libéraux comme
l’ancien ministre Yves Guyot, directeur du journal dreyfusard Le Siècle,
de défendre avec lucidité un paradigme d’engagement dans la
Cité : « Une grande crise morale a le noble privilège d’élever
les hommes au-dessus d’eux-mêmes, de faire tomber bien des préjugés, de
rapprocher bien des volontés, de dissiper bien des malentendus… Elle ne peut
refaire les esprits. » En fait, c’est par le haut que l’association sort
de cette faillite en réclamant la suppression de toutes les notes secrètes
concernant tous les fonctionnaires ; en bref, l’arrêt d’une pratique de
fichage. Quelques mois plus tard, Francis de Pressensé admet avoir jeté
« dans la balance le poids de son autorité morale pour dénoncer au pays
le seul gouvernement auquel, depuis notre fondation, nous ayons dû un
commencement de satisfaction à la démocratie française. » De fait,
l’unité du Bloc des gauches est préservée et la révolution dreyfusienne
continue avec la loi de séparation des Églises et de l’État.
Autre
« crise de conscience » (Charles Péguy), les Grands Procès de Moscou.
Le contexte est fort différent, et là encore largement explicatif. La LDH,
après un acmé en 1932 – elle fédère alors quelque 180 000
adhérents et 2 400 sections –, ce « monument constitutif de la
République », selon la formule du dreyfusard, ligueur et ancien président
du Conseil Léon Blum à son congrès de 1937, demeure une association de masse,
aux fortes audience et influence. Le signe ? Sa participation dans la
formation du Front populaire, déterminante au lendemain du 6 février 1934,
journée de manifestation des ligues d’extrême-droite analysée à gauche comme
une tentative de coup d’État des « factieux ». En riposte, à
l’occasion du 14 juillet 1935, un manifeste est lu et un serment est pris, qui
illustrent le rôle de Victor Basch (et d’Émile Kahn), en lien notamment avec la
CGT, le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, et de multiples
autres organisations de gauche.
Le comité
national pour le Rassemblement populaire se réunit au siège de la LDH ; il est
chargé d’élaborer un programme commun et des accords de désistement dans la
perspective des législatives du printemps 1936. Victor Basch en prend
symboliquement la présidence. Cette union des gauches, y compris avec un PCF
qui a abandonné la tactique « classe contre classe », se réalise
alors que deux dictatures totalitaires s’établissent en Italie avec Mussolini à
partir de 1922, puis en Allemagne avec Hitler dès 1933. Les tensions en Europe
s’accroissent : remise en cause du Traité de Versailles par l’Allemagne
nazie, agression contre l’Éthiopie par l’Italie fasciste, guerre d’Espagne à la
suite du coup d’État de Franco.
Mais les
grands Procès de Moscou. Qu’est-ce à dire ? Staline mène une campagne
d’épuration idéologique en URSS en cherchant à éliminer les opposants
trotskistes ou alliés à Léon Trotski, dont des bolcheviks historiques comme Lev
Kamenev et Grigori Zinoviev. Saisie, la direction de la LDH faillit, à l’image
d’ailleurs d’autres associations. Elle soutient la démarche de son juriste
Raymond Rosenmark, louant son impartialité et son « raisonnement juridique
impeccable », ce qui est assurément contestable puisque les conclusions se
fondent sur les aveux des condamnés. La direction ne tient pas compte du
dysfonctionnement de la commission censée proposer un travail collectif, ne
s’associe pas aux autres structures d’enquête, allant jusqu’à refuser de
publier l’article critique de la journaliste Magdeleine Paz… Pourtant, vingt
ans auparavant, la LDH avait étudié en profondeur le régime bolchevique issu de
la Révolution de février et du coup d’État d’octobre 1917.
Car si
Victor Basch a clairement exprimé son « trouble » et ses
« angoisses », le dilemme antifascisme/pacifisme surplombe toute
analyse, au temps de l’arrivée massive des réfugiés italiens, allemands
(juifs), espagnols fuyant les dictatures et sollicitant la LDH, et alors que
l’URSS apparaît, avec les brigades internationales et avant le pacte
germano-soviétique, comme la patrie de l’antifascisme.
Quand la LDH en lutte pour la liberté
Au-delà de
ces contradictions, le mouvement se caractérise par de belles constantes. Plus
« l’Affaire est finie, plus elle prouve », a affirmé Charles Péguy.
Qu’on en juge à travers ces quelques exemples.
Les libertés
sont au cœur de la « mission » – tel est le terme qui
transparaît alors de la rhétorique ligueuse, aujourd’hui délaissé par celui de
« mandat ». Mais, intraitable sur les principes, elle peut les
affirmer jusque contre son camp. Ce que l’historiographie a appelé
« l’affaire des officiers de Laon » dévoile l’un des fils rouges de
la tunique ligueuse, tissée tout au long de ces 125 années. Nous sommes au
temps de la lutte contre le cléricalisme, au lendemain de la séparation des
Églises et de l’État, quand la LDH prend la défense d’officiers catholiques,
sanctionnés pour avoir assistés, en dehors de leur service et en civil à la
messe. Le ministre de la Guerre, l’ex-lieutenant Picquart devenu général, dans
un gouvernement présidé par le dreyfusard Clemenceau, applique une vision
restrictive de la laïcité. À l’occasion de cet affrontement entre deux gauches
irréconciliables, la LDH, non sans remous en son sein, condamne la
« violation inadmissible du principe de la liberté de conscience ».
Et perd en quatre ans la moitié de ses adhérents.
En
l’occurrence, alors que Ludovic Trarieux, l’ancien rapporteur aux Sénat des
« lois scélérates » avait rejoint Francis de Pressensé dans la
condamnation de celles-ci , la LDH défend toutes les libertés. C’est une ligne
dont elle n’a pas dévié, considère-t-elle : de la loi de 2004 sur les
signes religieux dans l’école publique, la LDH pointant « l’exclusion dont
est déjà victime toute une catégorie de population » et estimant que
l’accès de tous les enfants à l’école laïque constitue la meilleure chance
d’émancipation, d’une part, jusqu’aux recours contre les arrêtés municipaux
interdisant le port des burkinis sur la plage ou contre l’installation de
crèches par certaines mairies aujourd’hui, d’autre part.
Cette
attention à toutes les libertés, y compris syndicales, s’élargit avec
l’intégration des droits économiques et sociaux, à la fin de la présidence de
Ludovic Trarieux et plus encore avec son successeur Francis de Pressensé. En
1904, elle prête une assistance à la fois pécuniaire et judiciaire à des
ouvriers grévistes emprisonnés ; en 1907, elle soutient les dirigeants de
la CGT emprisonnés pour « complot » et proteste contre l’application
du droit commun ; en 1910, elle intervient dans l’affaire Jules Durand, un
docker syndicaliste condamné à mort pour le meurtre d’un ouvrier « jaune »
dans une rixe, une « affaire Dreyfus ouvrière » au destin
tragique : Jules Durand, gracié, est libéré, mais il a perdu la
raison ; en 1920, elle demande l’amnistie des marins de la mer Noire et la
libération de leur leader André Marty. Ces combats se traduisent par de
nombreux départs : l’association est passée de quelque 89 000
adhérents en 1909 à 48 000 en 1913. Épuisement du dreyfusisme ou divisions
classiques dans une association plurielle inscrite en politique qui peine à
trouver le bon positionnement d’action au regard des principes ?
En tout cas,
plus près de nous, en 1963, elle a pu blâmer la réquisition des mineurs en
grèves et, avant comme après Mai 68, l’instrumentation de la police nationale
contre les militants syndicalistes ou étudiants, ou les mesures d’expulsion contre
Daniel Cohn-Bendit ou d’interdiction contre la Ligue communiste d’Alain
Krivine.
Précisément,
l’un des raisons de l’actualité de la LDH en 2023, c’est bien sa réflexion et
son action dans les pratiques policières de la République qui ne garantissent pas
toujours les droits des citoyens. Là encore, l’attention est ancienne :
dès 1902, elle demande l’abrogation de la police des mœurs, qui permet une
fouille au corps des prostituées ; dix ans plus tard, elle entend
généraliser la judiciarisation des expulsions des étrangers y compris des
réfugiés et faire respecter le droit d’asile contre l’arbitraire de l’État. On
ne sera donc par surpris qu’elle condamne les camps construits pour enfermer
des républicains fuyant le franquisme, comme ceux internant des Algériens
pendant la guerre d’Algérie, comme la répression de la manifestation du 17
octobre 1961.
Ainsi
initie-t-elle des campagnes successivement contre les lois anti-casseurs
(1970), sécurité et liberté (1980), Perben (2002-4), Sarkozy (2003) et LOPPSI 2
(2011), aboutissant selon elle à une dérive sécuritaire, et interroge les
législations d’exception, tels les successifs états d’urgence depuis 2005 ou
les multiples fichages, d’EDVIGE au Fichier des personnes recherchées (FPR). Le
schéma national du maintien de l’ordre est réprouvé, avant comme après 2021,
parce qu’il ne permet pas une désescalade des tensions, singulièrement depuis
les manifestations contre la loi travail El Khomri (2016), le mouvement des
Gilets jaunes (2018-2019), ou l’opposition aux constructions de méga-bassines
(2023).
Les
poursuites contre des médias comme L’Express, France-Observateur
ou La Cause du peuple, les pratiques des groupes Hersant ou Bolloré, les
écoutes illégales contre des militants politiques, pacifistes en 1914-1918 ou communistes
en 1939, entrent dans son mandat de libertés. Elle prend ainsi la défense des
anciens ministres radicaux Joseph Caillaux et Jean-Louis Malvy poursuivis pour
défaitisme pendant la Première Guerre mondiale. Elle fait aussi campagne en
1921 en faveur de Sacco et Vanzetti puis des époux Rosenberg condamnés à mort
aux États-Unis. Sa force réside dans le fait qu’elle constitue une tribune de
dénonciation quand l’État de droit est atteint, mais aussi dans ses actions
empiriques et les conclusions qu’elle en tire. Dès ses origines, ce corps
intermédiaire monte ainsi un service juridique, lance des missions d’enquête
(de celle sur l’antisémitisme en Algérie à celle sur les manifestations
étudiantes contre la loi Devaquet et la mort de Malik Oussekine en 1986, de
celle sur les 25 morts d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie en 1988), lance ou intègre
des collectifs avec des partenaires comme le MRAP, le SAF, le SM, la FCPE, la
Cimade, le Gisti, la Ligue de l’enseignement, la Fondation Copernic, pour ne
citer que ceux-ci.
Dernièrement,
le rapport public sur les Brav-M, ces brigades policières à moto recréées en
2019 après le démantèlement des Voltigeurs, ou celui à venir sur les violences
qui ont marqué le rassemblement à Sainte-Soline, rédigés dans le cadre
d’Observatoires des libertés et des pratiques policières, l’identifient, de la
part des pouvoirs, comme une empêcheuse de tourner en rond puisqu’elle dénonce
les abus de droit – et donc les manquements à la déontologie policière.
Face à l’accroissement des contrôles au faciès et aux poursuites pour outrage
et rébellion, bref à une « justice d’abattage » (Henri Leclerc)
s’inscrivant dans une politique du chiffre et de la répression du délit de
solidarité, elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’Homme qui a maintes fois condamné la France pour les dysfonctionnements de
ses forces de l’ordre.
Un patrimoine et un avenir
Suivre la
trajectoire de la LDH permet donc de montrer comment l’histoire du Droit et
l’histoire des droits s’entremêlent, comment l’histoire de la Justice et celle
des justices se superposent, et plus encore comment l’histoire politique et
l’histoire du politique se croisent et se retrouvent. La vocation de la LDH
s’exerce, en outre, au service d’une certaine vision de l’État de droit :
la réaffirmation, la consolidation, la protection mais encore l’extension des
droits de l’Homme doivent être replacées dans une République revivifiée, plus
ouverte et plus juste, dans le cadre d’une démocratie non seulement politique mais
sociale.
Au départ,
la LDH réactive les référents républicains, approuve et éprouve une conception
libérale et individualiste de droits naturels, sacrés, universels et
inaliénables face à des pouvoirs étatiques négligents, limitatifs ou
annihilants en matière de droits. Mais peu à peu, elle se saisit de l’héritage
de 1793, outrepasse une dimension recognitive et se transforme en espace de
sommation de droits considérés comme légitimes et possibles, en particulier les
droits-créances. Elle applique ainsi une conception in situ du droit
qu’elle veut progressive et progressiste en se penchant sur la troisième
génération de droits qui infère la notion de solidarité. Clairement, ce
laboratoire des idées et des pratiques balançant entre l’individu et un État à
contrôler, s’insère de plus en plus dans la dialectique entre le citoyen et les
pouvoirs, entre le vote et les partis, entre l’anomique et l’institutionnel. En
cela, la LDH propose une socialisation des citoyens et reflète un type de
sociabilité. En cela, la LDH se place tour à tour et en même temps, en-deçà et
par-delà le Parlement, le gouvernement, de l’État.
Par
ailleurs, si elle bataille pour le formalisme, elle tente aussi de dire le
droit en s’attachant à sa substance même, en combattant pour les droits
subjectifs authentiquement protecteurs des individus comme à ces droits
collectifs favorables au mouvement social, par-delà ses attentes d’un État
social. Débordant la vision d’un homme abstrait, la LDH replace les droits dans
le politique car, à ses yeux, le juridique, à la fois reflet et production
d’une société, est l’expression d’une projet politique.
Transcendant
la révolution dreyfusienne et prenant acte du dernier terme de la Déclaration
de 1789, cette scène de la demande citoyenne appréhende le mythe fondateur que
fut l’Affaire comme une postérité. Elle dépasse la seule éthique par une
articulation politique avec un message, des choix, une image qui la font
dépasser le statut de simple groupe de pression et lui donnent sa légitimité.
Moins observatrice qu’actrice, experte tout en étant généraliste, reconnue par
ses capacités d’appréciation et d’intervention, ce pôle participe ainsi à la
démocratie en approfondissant la culture républicaine. La LDH dessine même un
dessein avant tout civilisationnel puisqu’elle entend, par un travail de
construction, déconstruction et reconstruction, accomplir l’humanité,
puisqu’elle associe, au-delà de quelques contradictions, une promesse et un
pari.
Emmanuel Naquet Historien, Chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po Paris et membre des comités de rédaction d'Histoire@Politique
=====
La Ligue des droits de l’homme contre l’État ?
AOC - Par Éric Agrikoliansky Politiste - 8 mai 2023
Lorsqu’il a menacé la Ligue des droits de l’homme de
supprimer ses subventions, Gérald Darmanin s’inscrivait dans une série de
clivages idéologiques dans lesquels se reconnaît de longue date une partie de
la droite, qui voit dans la « défense des droits de l’homme » le paravent d’un
dangereux activisme marqué à gauche, voire à l’extrême gauche, destiné à
subvertir l’autorité de l’État. C’est d’ailleurs un terrain d’entente possible
avec l’extrême droite.
Gérald Darmanin a évoqué, mercredi 5 avril 2023
devant la commission des lois du Sénat, la possibilité de remettre en cause les
subventions données par l’État à la Ligue des droits de l’homme (LDH) : ce
soutien financier « mérite d’être regardé dans le cadre des actions qui
ont pu être menées » par la LDH a affirmé le ministre de l’Intérieur…
C’est la dénonciation par l’association des conditions
de maintien de l’ordre durant les événements de Sainte-Soline qui semble avoir
été à l’origine de ces propos. Des membres de la LDH, participant en tant qu’observateurs,
ont pu témoigner des violences commises contre les manifestants opposés aux
mégabassines et constater que la lenteur des secours portés aux manifestants
blessés pouvait refléter une obstruction délibérée des forces de l’ordre. En
outre, la LDH avait attaqué un arrêté préfectoral visant la protestation
anti-bassines interdisant le transport « d’armes par destination »,
c’est-à-dire à peu près n’importe quel objet pouvant être utilisé comme
projectile, ce qui est contraire selon la LDH à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel.
Le 12 avril, la Première ministre Élisabeth Borne a
ajouté, toujours devant le Sénat, que si elle avait « beaucoup de respect pour
ce que la LDH a incarné », elle ne comprenait plus « certaines de ses prises de
position », évoquant « ses ambiguïtés face à l’islamisme radical ». Le
président de la LDH, Patrick Baudouin, s’est déclaré « surpris de la
déformation » de la position de l’association : « L’amalgame que fait Mme Borne
me hérisse et me révolte », il faut, a-t-il poursuivi, « apaiser le débat et
non […] envenimer les choses » (Le Monde, 12 avril 2023).
De nombreuses voix se sont élevées pour condamner ces
menaces contre la LDH, dont une pétition publiée en une de L’Humanité
s’inquiétant de la « gravité extrême » de cette « intimidation à peine voilée
(…) concernant une association centenaire, reconnue pour son action exemplaire
dans la protection des libertés et le respect de l’État de droit. »
Au-delà de l’indignation manifestée par ceux qui se
préoccupent de la liberté des associations, on peut s’étonner de ces attaques
contre un collectif comme la LDH. D’abord parce que l’histoire de l’association
se confond avec celle de la construction du régime républicain : fondée en 1898
pour regrouper les défenseurs de l’innocence de Dreyfus, elle a joué tout au
long de la IIIe République un rôle central dans la défense des droits
fondamentaux, des libertés publiques et plus largement du régime républicain,
notamment menacé par les Ligues s’inspirant du fascisme ou revendiquant la
destruction de la République – comme l’Action française de Charles Maurras,
mouvement monarchiste violent et antisémite.
Dissoute sous l’Occupation, son siège est pillé et ses
archives confisquées par les nazis à la quête de fichiers recensant ceux qu’ils
traquaient (militants antifascistes, juifs, francs-maçons). Envoyées à Berlin,
ces archives seront emportées à Moscou par les soviétiques à la fin de la
guerre avant qu’une partie ne soit restituée à la Ligue en 2000. À la fin de
l’Occupation, en 1944, le dernier président Victor Basch et sa femme, âgés de
plus de 80 ans, sont assassinés par la milice.
Il est évidemment particulièrement maladroit
politiquement de mener ces attaques contre la LDH, son histoire et ce qu’elle
représente, même la Première ministre le reconnaît implicitement tout en
affirmant que l’action de la LDH a profondément évolué et que certaines de ses
actions pourraient menacer la République… La LDH a évidemment évolué. Exsangue
à la Libération (elle ne compte plus que quelques dizaines de milliers
d’adhérents alors qu’elle en revendiquait 180 000 dans les années 1930), la LDH
se reconstruit très progressivement dans les années 1960 et 1970, notamment
sous l’influence de deux de ses présidents, Henri Noguères et Daniel Mayer –
qui présidera le Conseil constitutionnel de 1983 à 1986 et que l’on peut
difficilement qualifier d’activiste « d’ultra-gauche »….
La ligue se revivifie et recrute l’essentiel de ses
soutiens dans les milieux intellectuels modérés : enseignants du
secondaire, universitaires, avocats qui affirment un attachement constant à la
légalité républicaine et recherchent à la LDH un engagement civique et moral à
côté des partis politiques, mais au-dessus de ceux-ci[1].
Investie par un nombre croissant de juristes dans les années 1970 et 1980, la
direction de la Ligue défend des positions toujours légalistes, visant à agir
par le droit, pour faire changer la loi, mais toujours en respectant le droit.
L’activité de son service juridique, qui fournit des conseils juridiques
bénévoles et discute avec les administrations les conditions d’application du
droit, en témoigne. Comme le suggérait Victor Basch au congrès de 1929 de la
LDH, celle-ci : « ne se borne pas à prendre en charge la portion de
justice inscrite dans la loi, elle veut inscrire dans la loi la totalité de la
justice ».
Certes, la Ligue n’a jamais caché son ancrage à
gauche : dans la première partie du XXe, elle est un espace d’échange
entre radicaux et membres de la SFIO. En 1934-1936, au nom de la lutte
antifasciste, la LDH joue d’ailleurs un rôle important dans les discussions
préalables à la constitution du Front populaire. Dans les années 1970 et 1980,
de nombreux adhérents sont passés par les différentes organisations de la
gauche française (PSA, PSU, SFIO puis PS, dissidents du PCF…).
Néanmoins, la Ligue a toujours conservé son
indépendance à l’égard des partis en refusant de s’aligner derrière les positions
d’une organisation en particulier. De plus, il faut souligner que les ligueurs
se sont toujours placés à une distance prudente des idéaux révolutionnaires
professés par ailleurs par les communistes, puis par l’extrême gauche
française. Le PCF et l’extrême gauche trotskistes dans les années 1960 se
gardent d’ailleurs eux-mêmes de revendiquer la cause des droits de l’homme,
idéal bourgeois à leurs yeux : la défense des droits formels ne devant pas se
substituer à la réalisation d’une véritable Révolution sociale (le PCF
interdira d’ailleurs dans l’entre-deux-guerres l’appartenance de ses membres à
la LDH, comme à la Franc-maçonnerie dont sont issus certains ligueurs).
Enfin, si la Ligue a pu incarner la « bonne
mémoire » d’une gauche humaniste et soucieuse des libertés publiques, elle
ambitionne aussi d’être aussi la « mauvaise conscience » de la gauche
(selon la formule d’Yves Jouffa qui présida la LDH dans les années 1980)
lorsque celle-ci était au pouvoir en critiquant largement son action.
Considérer que la LDH pourrait encourager, voire
soutenir, l’islamisme radical et ses dérives violentes est évidemment
grossièrement faux.
Certes, les positions de la Ligue ont évolué sur un
certain nombre de sujets : farouche défenseur d’une laïcité
intransigeante, héritée de la séparation de l’Église et de l’État, et se
fondant sur un virulent anticléricalisme, les ligueurs ont récemment reconsidéré
la question, par exemple à propos du port de « signes religieux »,
considérant que leur prohibition était attentatoire aux libertés et visait
davantage à alimenter une islamophobie perçue comme rentable électoralement
qu’à assurer l’unité de la république. On peut évidemment être en désaccord
avec cette position, mais considérer que la LDH pourrait encourager, voire
soutenir, l’islamisme radical et ses dérives violentes est évidemment
grossièrement faux…
Alors quelle mouche a piqué le gouvernement pour qu’il
s’attaque ainsi à une association qui s’identifie pour nombre de citoyens aux
principes fondamentaux de la République, à la défense des libertés publiques et
à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ? Est-ce une provocation
accidentelle et mal maîtrisée de la part d’un ministre prêt à tout pour un peu
de publicité ? Peut-être en partie. Mais il faut aussi replacer ces attaques
dans le cadre idéologique qui lui donne sens et corps.
Il serait en effet trompeur de voir dans les propos
tenus par les membres du gouvernement des dérapages individuels incontrôlés.
Les menaces de Gérald Darmanin, qu’Élisabeth Borne a refusé de désavouer,
doivent au contraire se comprendre dans le cadre d’échanges avec des élus Les
Républicains dont les propos sur la LDH sont encore plus violents et réactivent
de vieilles lignes de clivages politiques.
Lorsqu’il affirme vouloir « regarder » les
subventions de la LDH, Gérald Darmanin acquiesce à une diatribe du sénateur LR
du Tarn-et-Garonne François Bonhomme[2],
qui appelait à « cesser de financer des associations qui mettent en cause
gravement l’État », dont la Ligue des droits de l’homme. Ligue des
« droits de l’homme par antiphrase » précise-t-il immédiatement. On
se demande d’ailleurs quel sens l’élu donne à cette formule : suggère-t-il
que la LDH est en réalité en lutte contre les droits de l’homme ?! Un peu
plus tard, selon Le Monde, le chef de file des sénateurs Les
Républicains, Bruno Retailleau, a proposé de « couper les
subventions » à la LDH, dénonçant une « terrible ambiguïté et même
une complicité » de l’association avec des organisations
« islamistes » : la LDH « a eu sans doute un noble passé,
un passé glorieux », mais elle est « en train de se perdre dans des
querelles […] d’extrême gauche ».
Hors de l’arène parlementaire, Catherine Nay dénonce
dans Valeurs actuelles (16 avril 2023) les « mensonges » de la
LDH à Sainte-Soline et l’accuse, pêle-mêle, d’être « hystériquement
anti-israélienne », de ne pas réagir devant « la recrudescence des
actes antisémites » et finalement de risquer de « détruire la France
républicaine ». Non seulement on ne voit pas bien en quoi l’évolution des
positions de la LDH sur la laïcité affecterait sa capacité à observer le
respect des libertés publiques (notamment le droit de manifester) par les
forces de l’ordre, mais aucun élément de preuve n’est évidemment avancé. Ce qui
frappe, c’est justement que ces dénonciations peuvent s’en dispenser.
Ces attaques s’adossent à une série de clivages
idéologiques dans lesquels se reconnaît de longue date une partie de la droite,
qui voit dans la « défense des droits de l’homme » le paravent d’un
dangereux activisme marqué à gauche, voire à l’extrême gauche, destiné à
subvertir l’autorité de l’État. C’est d’ailleurs un terrain d’entente possible
avec l’extrême droite. Il est ainsi significatif que l’une des premières
décisions de Steeve Briois (RN) lorsqu’il accéda à la mairie d’Hénin-Beaumont
en 2014 fut d’expulser la LDH du local dont la mairie lui concédait l’usage et
de supprimer sa subvention, au motif que l’association « d’extrême
gauche », à ses yeux, s’était ingérée « dans la vie politique
locale » (Le Monde, 8 avril 2014). Héritée de Barrès et Maurras,
des nationalismes obsidionaux qui se développent justement après l’affaire
Dreyfus contre les droits de l’homme et la LDH, l’obsession des racines, de la
préservation de l’identité, de la « terre et des morts », travaille
toujours une partie de la droite, comme en témoigne l’entreprise Zemmour.
Faut-il ainsi s’étonner de ces menaces émanant d’un
ministre de l’Intérieur qui a collaboré à un journal lié à l’une des scissions
de l’Action française (Politique magazine, dont le fondateur Hilaire de
Crémiers dirigea le groupuscule Restauration nationale après avoir quitté
l’Action française). Quelle que fût la nature exacte des relations du ministre
avec les différentes fractions issues de l’Action française[3],
on ne peut pas penser qu’il ignore tout à fait l’histoire de la LDH et des
clivages qui l’opposèrent à l’Action française maurassienne. Menacer la LDH est
donc tout sauf accidentel de sa part.
Bien entendu, il serait absurde d’accuser la droite
parlementaire, et une partie du gouvernement, d’adhérer sans réserve au
monarchisme xénophobe maurassien, mais il faut simplement constater que
certaines catégories de pensée héritées de Maurras n’ont pas totalement disparu
et peuvent conserver leur force structurante, au moins pour mobiliser les
franges les plus réactionnaires de l’électorat de droite dans des moments
d’exacerbation des clivages. L’opposition « pays réel/pays légal[4] »
exhumée par Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé au début des années 2010,
réactivée au moment de la Manif pour tous, a aussi été réutilisée par Emmanuel
Macron en février 2020 (justement au moment d’une première tentative de réforme
des retraites…) pour justifier de la nécessité de réinvestir la question de
l’immigration ou de la « lutte contre le séparatisme »[5].
C’est lorsqu’il faut rallier la droite que la régression vers ces clivages
élémentaires de la vie politique semble retrouver son utilité…
Au-delà du nationalisme et de la xénophobie, il faut
souligner que ce que dénoncent aujourd’hui, comme hier, les adversaires de la
Ligue des droits de l’homme, c’est aussi et surtout le rôle joué par les
« intellectuels » dans la vie publique. L’affaire Dreyfus marque en
effet la « naissance des intellectuels[6] »
au sens de l’émancipation d’un ensemble d’universitaires, de juristes, de
savants qui s’appuient sur leur compétence pour intervenir dans l’espace public
et s’opposer à la raison d’État, réclamer la transparence de ses procédures,
voire le mettre en cause pour défendre les libertés individuelles. Ce
rassemblement d’intellectuels que constitua la Ligue dès sa création[7]
vise précisément à réaliser l’idéal d’un pouvoir fondé sur le droit,
susceptible d’être passé au crible de la raison et devant rendre des comptes
aux citoyens.
C’est son rôle de contre-pouvoir qui semble être la
cible principale des attaques menées par quelques élus de droite à l’encontre
de la LDH.
C’est contre la foi aveugle dans les « dogmes simples
et intangibles : l’armée, la nation, l’autorité[8]
», et « l’apologie du mensonge » que justifierait la raison d’État,
que se constitue la Ligue. Ce que dénoncent les dreyfusards, ce sont les graves
irrégularités qui entachent la condamnation de Dreyfus et le refus par l’État
de les reconnaître, alors même que la preuve de son innocence peut en être
établie factuellement (c’est par exemple l’objet de l’ouvrage de Jean Jaurès,
Les preuves, publié en 1898[9]).
La Ligue va ainsi placer dans la première partie du XXe siècle au centre de son
action le fonctionnement de la justice (procédure pénale, campagnes contre la
peine de mort, etc.), de l’armée (la réhabilitation des fusillés de la Grande
Guerre par exemple) ou les interventions dans des erreurs judiciaires. Après
1945, au moment de la guerre d’Algérie, les ligueurs se mobilisèrent contre les
mensonges de l’armée à propos de l’assassinat de Maurice Audin.
Or, c’est ce rôle de contre-pouvoir qui semble être la
cible principale des attaques menées par quelques élus de droite à l’encontre
de l’association : que celle-ci puisse s’opposer au récit fait par les
forces de l’ordre et par le ministère de l’Intérieur des conditions du maintien
de l’ordre à Sainte-Soline, qu’elle demande des comptes et contribue à établir
des faits beaucoup plus troubles que ne le laisse penser les déclarations d’un
ministre de l’Intérieur décrivant des forces de l’ordre comme le dernier
rempart contre les vagues déferlantes du black bloc… leur paraît insupportable.
C’est ce dont témoigne, involontairement, François Bonhomme lorsqu’il affirme
au cours de la commission d’enquête du Sénat que « les conditions du
maintien de l’ordre ont été parfaitement respectées » à Sainte-Soline et
dénonce ces associations, comme la LDH qui « mettent en cause gravement
l’État »… On ne voit pas en quoi le rappel de la légalité par des
associations menacerait l’État de droit, alors qu’elles visent au contraire à
le défendre…
Les conditions d’exercice de la démocratie pluraliste
impliquent en effet l’existence de contre-pouvoirs indépendants de l’État,
voire appartenant à l’opposition politique (c’est le principe même de la
démocratie pluraliste…), susceptibles de demander des comptes et de fournir un
contre-récit à ceux du pouvoir justement. Doit-on confier à la gendarmerie le
soin de statuer seule sur le bien-fondé de sa propre action[10] ?
Peut-on se contenter des affirmations du ministre de
l’Intérieur renvoyant à des notes confidentielles des services (DRPP, DGSI)
justifiant la répression policière, lors des manifestations contre la réforme
des retraites après le 16 mars, par la nécessité de s’opposer à une
« ultra-gauche » qui souhaiterait, selon des notes confidentielles de
ces services, « prendre la direction du mouvement social » ?
Peut-on laisser aux institutions d’État le seul soin
de juger des conditions d’usage de la « violence légitime », formule
empruntée à Max Weber et utilisée sans cesse pour justifier la
répression ? Ceux qui l’emploient oublient la plupart du temps que la
légitimité n’est jamais acquise, mais doit être encadrée par le droit et être
justifiable publiquement – au risque de ne plus être très longtemps considérée
comme légitime par les citoyens… Un État irréprochable et légitime doit pouvoir
supporter (dans tous les sens du terme, y compris financier) un tel regard
public et critique sur une action dont il est redevable auprès des citoyens.
Au final, menacer les contre-pouvoirs comme la LDH,
tandis que la « normalisation » de l’état d’urgence dilue les
frontières entre démocratie et autoritarisme[11]
et alors que l’extrême droite est aux portes du pouvoir, c’est plus qu’une
faute politique, c’est une erreur historique qui pourrait se révéler à terme
fatale pour la démocratie.
Politiste, Professeur des universités à Paris
Dauphine-PSL et membre de l'IRISSO
Ligue des droits de l’homme : « La défense des libertés est devenue le sujet le plus brûlant de la période » Le Monde -Tribune
Le mépris de la démocratie parlementaire et sociale s’étend désormais aux droits fondamentaux, que la LDH a toujours défendus et défendra toujours, affirment, dans une tribune au « Monde », son président, Patrick Baudouin, et ses présidents et présidente d’honneur. Publiée le 3 mai 2023
Depuis quelques jours, le procès est instruit,
tambour battant. La Ligue des droits de l’homme (LDH) ne serait plus elle-même,
elle aurait changé, basculé du côté obscur des forces ennemies de la
République, islamistes et autres « écoterroristes »… Les
procureurs se bousculent : un ministre de l’intérieur, une première
ministre s’activent aux côtés d’une brochette de polémistes toujours prompts à
chasser en meute le « droit-de-l’hommiste ». L’un propose que l’on examine de près ses ressources, l’autre enfonce le clou.
Qui a changé ? Certainement pas la LDH.
Fondée dans la lutte contre l’antisémitisme et une raison d’Etat prévalant sur
les droits de l’homme et du citoyen, elle n’a jamais renié les principes de
défense universelle des droits qui la guident depuis cent vingt-cinq ans.
Contre la peine de mort, elle a défendu le droit à la vie ; contre
l’arbitraire des tribunaux militaires, elle a obtenu leur dissolution ;
contre la torture et les traitements dégradants, elle a défendu le droit à un
procès équitable. Elle s’est dressée contre l’intrusion proliférante des
fichiers, elle a campé aux côtés des indépendantistes kanaks, joué un rôle dans
le processus de paix au Pays basque, combattu les violences policières, quels
que soient les gouvernements en place.
Elle a fait vivre la fraternité aux côtés des
migrants et des sans-papiers, elle combat aujourd’hui pour l’effectivité du
droit à l’interruption volontaire de grossesse, accompagne les manifestations
pacifiques pour une vraie politique face au changement climatique. La LDH, oui,
considère, même lorsque cela dérange les pouvoirs en place, que les droits
fondamentaux valent pour toutes et tous. Qu’ils valent donc pour des personnes
dont elle n’approuve rien des idées ni des actes, qu’il s’agisse des collaborateurs
en 1945 ou des djihadistes d’aujourd’hui.
Etranges
« libéraux »
Certes, cela agace ; mais qui a
changé ? Certainement pas la LDH, bien au contraire, et c’est ce qui
déclenche cette attaque, au caractère réfléchi et qui vise plus large qu’il n’y
paraît. Qui a changé ? Celles et ceux-là mêmes qui nous font ce procès,
ces étranges « libéraux » qui, par-delà la LDH, mettent en œuvre la
mise en cause de l’ensemble des garanties des libertés publiques. Comme s’il
s’agissait d’intimider tout acteur indépendant et critique à un moment… tout
aussi critique.
La liberté de manifester ? Elle est mise en
cause par le durcissement des instructions données aux forces de police et de
gendarmerie, y compris à l’égard de citoyennes et citoyens non violents. Cela
se traduit par des blessures graves, des mutilations, voire pire, et par une
instrumentalisation toxique des forces de police. On assiste ainsi au retour
des charges de brigades mobiles à moto, proscrites depuis la mort de Malik
Oussekine en 1986, et à un usage disproportionné d’armes qu’aucune autre police européenne n’emploie en pareil cas.
A Sainte-Soline (Deux-Sèvres), de nombreux manifestants ont été blessés, dont
deux en danger de mort, tardivement secourus.
A Paris, des manifestations ont été interdites au
dernier moment et si discrètement que la justice administrative a désavoué le
préfet de police. Ajoutons que la pratique devenue systématique
d’interpellations « préventives » a empêché de manifester des
centaines de citoyennes et citoyens qui n’ont évidemment fait ensuite l’objet
d’aucune poursuite. La liberté d’association est logée à la même enseigne.
Depuis 2021, le décret sur le prétendu « contrat »
d’engagement républicain vise à asphyxier les associations indépendantes et critiques,
dont plusieurs ont déjà été l’objet d’intimidations préfectorales.
Chaque événement semble propice à ce gouvernement
pour renforcer un appareil sécuritaire. La surveillance systématique de la
population va augmenter du fait de la loi récente utilisant la perspective des
Jeux olympiques pour introduire la surveillance de millions de personnes à la
recherche de « comportements anormaux » par des drones et des
caméras dites « intelligentes ».
Les droits des étrangers, y compris le droit
d’asile, vont à nouveau être restreints par un ensemble de lois dont le
président de la République semble avoir déjà décidé du contenu. Et, comme
toujours, la chasse aux étrangers continuera d’affaiblir les droits de toutes
et tous. S’il n’avait tenu qu’à ce gouvernement, tous les enfants français de
Syrie continueraient de croupir dans des camps. La LDH a été en première
ligne du combat humanitaire pour leur rapatriement, inachevé à ce jour. Aujourd’hui,
l’exécutif en vient à ficher ces mêmes enfants « préventivement »
en présumant une sorte d’hérédité terroriste. De ce côté-là, hélas, rien ne
change…
Crise
démocratique profonde
Le moment de ces attaques n’a rien de
mystérieux : démocratie et libertés ont toujours partie liée. Or, le
passage en force d’un pouvoir privé de majorité parlementaire, désavoué par une
large majorité de citoyennes et citoyens, et contesté par la totalité des
organisations syndicales de ce pays, vient de mettre en lumière un blocage sans
précédent de l’agenda politique du « monarque républicain » et une
crise démocratique profonde, touchant à la fois le fonctionnement réel des
institutions de la République, le dialogue social, la confiance des citoyennes
et citoyens en celles et ceux qui ont le devoir de les représenter et de les
respecter.
Tout se passe comme si le pouvoir actuel avait en
tête, avec ce tournant autoritaire, de pouvoir sortir de son impasse politique
en recherchant à tout prix une nouvelle majorité sans rivages à droite.
Agresser la LDH dans ce contexte est de bonne tactique. Tant pis si les citoyennes
et citoyens ont été trompés, à qui l’on avait demandé de voter contre l’extrême
droite et qui avaient entendu le vainqueur par défaut de la présidentielle en
2022 assurer : « J’ai conscience que ce vote m’oblige pour
les années à venir. » Tant pis s’ils doivent subir la régression des
droits à laquelle ils pensaient faire barrage. Tant pis si tout cela ouvre la
voie au pire.
La défense des libertés est ainsi devenue le
sujet le plus brûlant de la période : le mépris de la démocratie
parlementaire comme sociale s’étend désormais aux droits fondamentaux. C’est
pourquoi la Ligue des droits de l’homme ne changera pas. Changer serait
renoncer à assurer pleinement la mission qui est sa raison d’être aujourd’hui
comme hier. Qu’on n’y compte pas : nous appelons au contraire l’ensemble
des citoyennes et citoyens et des organisations attachées au respect de l’Etat
de droit à se mobiliser face à des gouvernants qui semblent avoir perdu plus
que leur sang-froid : le sens même de leurs responsabilités.
Patrick Baudouin est président de la Ligue des droits de l’homme (LDH) ; Jean-Pierre Dubois, Françoise Dumont, Henri Leclerc, Malik Salemkour et Pierre Tartakowsky, présidents et présidente d’honneur.
=====
Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH : «L’Etat a tendance à vouloir étendre son pouvoir, il faut des contre-pouvoirs pour le contenir» - Libération
Fort
de soixante-cinq ans d’engagements, l’avocat et président d’honneur de la
Ligue des droits de l’homme dresse un état des lieux inquiet de la situation
des libertés en France, et appelle à protéger les remparts judiciaires ou
associatifs contre les excès du pouvoir.
par Clémence Mary et Anastasia Vécrin
publié le 1er mai 2023 à 14h42
Une possible remise en question de ses subventions par le
Ministre de l’Intérieur, des prises de position qualifiées d’incompréhensibles
par la Première ministre, la Ligue des droits de l’homme (LDH) est-elle devenue
une ennemie de l’Etat, ou vice-versa ? Ces attaques, Henri Leclerc les connaît par cœur. Depuis la
première fois qu’il y a mis les pieds en 1958, l’avocat pénaliste porte les
combats de l’association centenaire, qu’il a dirigée un temps avant d’en
devenir le président d’honneur. Du haut de ses soixante-cinq ans de carrière,
ce «droit-de-l’hommiste» revendiqué observe avec lucidité et inquiétude la
place fragile des libertés fondamentales dans la société, et celle d’un Etat de
droit toujours soumis aux assauts du pouvoir. Toujours affûté, il rebondit sur Mayotte, les violences sexuelles, la disparition des jurys populaires et nous parle de sa
conception du métier d’avocat.
Vous avez pris votre retraite en 2021 mais vous
continuez à intervenir régulièrement dans le débat public. Vous avez encore le
feu sacré ?
Mes soixante-cinq ans d’expérience d’avocat, mon
engagement au service des droits de l’homme, continuent à servir. On me
sollicite encore un peu car je suis un papy du barreau ! Je constate que le
combat pour les droits de l’homme reste aujourd’hui une nécessité absolue, à
tel point qu’il dérange les autorités et les pousse à s’attaquer à cette
vieille institution qu’est la LDH. Or nos engagements sont justes, comme on le
voit à Mayotte où la décision du tribunal judiciaire a validé nos prises de
position. Une gifle pour l’Etat et Darmanin qui en avait fait un
engagement personnel.
Pourquoi la défense des droits de l’homme
provoque-t-elle des tensions avec l’Etat, qui est censé garantir l’Etat de
droit ?
L’Etat a souvent tendance à vouloir étendre son pouvoir,
c’est pourquoi il faut des contre-pouvoirs pour le contenir. La Ligue s’est
constituée en pleine affaire Dreyfus, et tout de suite, elle a été
momentanément interdite, perquisitionnée. Ses combats n’ont pas cessé et ont
été souvent critiqués, bien que le plus souvent justes. Après la guerre de
1914, elle s’est battue pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple, et
a affronté la colère des anciens combattants, qui l’accusaient de défendre les
traîtres… Elle est interdite pendant l’Occupation, et son président Victor
Basch a été assassiné avec sa femme par la milice. A la Libération, même
décimée, elle proteste contre les excès de l’épuration sauvage et la justice
expéditive subie par les collaborateurs. Puis elle dénonce la torture pendant
la guerre d’Algérie, ou en 1996 la brutale effraction de l’église Saint-Bernard où
s’étaient réfugiés des sans-papiers.
Comment expliquez-vous les attaques de Gérald Darmanin
contre la LDH ?
Que Darmanin remette en question nos subventions, ce n’est
encore qu’une menace, un chantage, elles sont minoritaires dans le budget de
l’association. Mais cela pose le problème de l’existence d’un contre-pouvoir.
D’autres associations voire des institutions ne seraient-elles pas aussi dans
son viseur, comme la Défenseure des droits, la Contrôleuse des lieux de
détention et de privation de liberté, la Commission nationale consultative des
droits de l’homme (CNCDH) ? Il faut que l’Etat accepte l’existence de
contre-pouvoirs or il renâcle : quand la LDH a fêté son centenaire en 1998,
contrairement au président Chirac qui est venu, le chef du gouvernement
pourtant socialiste, Lionel Jospin, quoique attendu, a refusé !
Volonté de dissoudre les Soulèvements de la Terre, hausse des saisines
de la Défenseure des droits… Assiste-t-on selon
vous à un recul des libertés individuelles et collectives ?
Oui mais cette menace a toujours existé, cela n’a pas
empêché l’acquisition de nouvelles libertés que la LDH réclamait comme
l’abolition de la peine de mort, l’IVG ou le mariage pour tous. La notion
d’Etat de droit repose sur un équilibre entre l’affirmation des libertés et des
droits – et la nécessité d’en préciser les contours. Prenons la liberté
d’expression : «Un des droits plus précieux» selon la Déclaration des
droits de l’homme, mais ceux qui en usent ont à «répondre des abus dans les
cas déterminés par la loi». Globalement, sous la pression de la Cour
européenne des droits de l’homme, elle a progressé. Mais l’explosion des
réseaux sociaux, les menaces pesant sur la liberté économique des médias et
donc sur leur indépendance, la menace d’une monopolisation par Bolloré des moyens
d’expression, oblige à la vigilance.
Quid de la liberté de manifester, qui est aussi un
droit fondamental ?
Depuis la «loi anticasseurs» de 1970 – abrogée par
Mitterrand en 1981 –, des lois ont toujours cherché à limiter la liberté de
manifester, notamment la loi «sécurité globale» de 2021. Aujourd’hui, les
arrestations et les gardes à vue préventives de manifestants pacifiques, qui
existent contrairement à ce que dit Darmanin, sont une atteinte à ce droit.
Participer à une manif, même interdite, n’est pas une infraction. La LDH a
d’ailleurs fait annuler un arrêté du préfet de Paris qui ne respectait pas le
délai indispensable pour prononcer l’interdiction d’une manifestation.
L’usage de la violence par les forces de l’ordre est-il
toujours légitime ?
La violence de la police n’est pas forcément légitime.
Comme le prévoit la Déclaration des droits de l’homme, «la garantie des
droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique» mais c’est «pour
l’avantage de tous». A l’époque de Mai 68, les policiers étaient intervenus
de façon brutale dans la Sorbonne et des manifestants avaient été arrêtés. Mais
les recommandations du préfet de police et les syndicats de policiers prônant
la proportionnalité et la modération avaient évité des drames. Nul ne conteste
que le port d’armes par les manifestants ou l’agression des forces de police
sont répréhensibles, et que les policiers doivent pouvoir se défendre s’ils
sont attaqués. Mais il faut que cette force soit assortie d’obligations : la
nécessité impérative de son usage et sa proportionnalité. Les observateurs
témoignent souvent qu’elles ne le sont pas. Ce qui est à l’origine de ces
violences, c’est le plus souvent une stratégie inadaptée et dangereuse comme la technique de la nasse. Ensuite, il y a le problème de
la protection constante de la hiérarchie. Qui certes ne donne pas toujours la
consigne d’utiliser la force de manière disproportionnée, mais elle couvre les
excès qui sont faits pour limiter le droit de manifester – en vain d’ailleurs.
Et cette hiérarchie n’est jamais mise en cause.
On assiste depuis plusieurs années à la multiplication
des lois, sous le coup de l’émotion. Les crises sanitaires ou politiques
justifient-elles une restriction des libertés ?
Sous prétexte de restreindre la liberté des supposés
«ennemis», on restreint celle de tous. La première loi instaurant l’état
d’urgence date de 1955 au commencement de la guerre d’Algérie et elle renaît
périodiquement ensuite dès que l’opinion publique est secouée. La loi «sécurité
et liberté» abrogée en 1981 limitait la protection des libertés alors même
qu’elle ne se justifiait par aucune crise réelle. Depuis, presque tous les ans,
les lois visant à réduire les libertés se succèdent. Mais ce n’est pas la
multiplication des lois sécuritaires qui a entravé le terrorisme. J’étais à la
CNCDH quand on a fortement critiqué la loi Cazeneuve en 2015 qui, pour faciliter le travail des
renseignements, accordait à l’Etat des facilités nombreuses, notamment pour les
écoutes téléphoniques. La loi sur l’état d’urgence, prolongée après les crimes
terroristes massifs de 2015, n’a cessé d’être renouvelée, jusqu’à être
introduite par morceaux dans le droit commun. Que l’Etat profite des moments de
peur collective pour restreindre les libertés me paraît dangereux.
Comment s’opposer légalement à ces restrictions ?
Il y a toujours eu des résistances de la part des organisations,
des institutions, des associations et de la justice, qu’elle soit
administrative ou judiciaire. La justice est là pour exécuter les lois mais
aussi pour les interpréter et contrôler les sanctions qui doivent être «strictement
et évidemment nécessaires». La justice reste donc, malgré son état de
délabrement, un petit rempart contre les atteintes aux libertés. La présomption
d’innocence est une limite très forte aux excès de la répression.
l’instauration de l’Ecole nationale de la magistrature ou l’essor des syndicats
de magistrats ont aussi permis de réduire la notion de justice de classe qui
était dénoncée au XIXe siècle.
Que pensez-vous de la place des victimes aujourd’hui
dans la justice ?
Si la justice doit absolument les écouter, elle existe avant
tout pour définir ce qu’est un acte délinquant, juger et condamner. Mais la
victime est aujourd’hui au cœur de l’institution, c’est une évolution
importante. L’opinion publique est très sensible aux droits des victimes. Mais
la justice n’est pas la vengeance. En parallèle a émergé très lentement comme
un désir, sinon de compréhension, au moins de dialogue, y compris avec les
accusés, par les projets encore incertains de justice restaurative. Le succès
du film Je verrai toujours vos visages en est le signe.
Vous mettre à la place de l’accusé, est-ce votre
conception du métier d’avocat ?
Le droit à la défense incarne le cœur battant de la
démocratie, c’est-à-dire la nécessité pour la société d’accepter une
contradiction, qui devient une fonction incarnée par l’avocat. Quand on défend
une personne, celle-ci paraît comme écrasée par la société. Accusée d’un
meurtre et livrée à la foule, elle serait lynchée. D’où la nécessité pour juger
de faire intervenir un corps intermédiaire défendant l’accusé qui autrement
serait seul. La première nécessité est bien entendu de défendre les innocents
injustement accusés, car parfois les charges qui pèsent sur eux sont
insuffisantes eu égard au respect du droit à la présomption d’innocence. En
soixante-cinq ans de carrière, j’ai plaidé des centaines de fois devant les
cours d’assises, où des citoyens constituaient des jurys populaires, une
instance datant de la Révolution française et qui est train de disparaître, je
le déplore. Dans la plupart des affaires, les accusés avouent mais ils ne
doivent être condamnés qu’à des peines «justes». Notre rôle est de les ramener
dans la communauté humaine.
Pourquoi déplorez-vous la disparition des jurys
populaires ?
Ce qui a présidé à leur création, c’est l’idée que la
justice doit être orale ; que la confrontation directe des points de vue, sur
des faits et la personnalité, contradictoirement débattus à l’audience, ne peut
pas être remplacée par la constitution de dossiers. C’est sous Vichy qu’on a
adjoint à ces jurys populaires, pour décider de la culpabilité, des magistrats
professionnels. Contrairement à une idée reçue, les citoyens peuvent très bien
prendre au sérieux ce type de mission, on l’a vu récemment à travers les
conclusions des Conventions citoyennes par exemple.
Faut-il forcément comprendre l’accusé pour bien le
défendre ?
Il faut adhérer à sa défense pour pouvoir plaider. Il
m’est arrivé de ne pas pouvoir défendre un accusé parce que je n’étais pas
d’accord, et je ne peux pas convaincre si je ne suis pas moi-même convaincu. Je
ne délivre pas de mensonge. Quand j’étais l’avocat de l’Unef, de Libération,
ou des militants «gauchistes» entre 1968 et 1980, je ne défendais pas la
justesse des actes commis ni une ligne politique – avec laquelle je n’étais pas
forcément d’accord – mais l’injustice des peines qui les frappaient. Les
affaires de viol m’ont passionné car c’est là que la difficulté pour restaurer
l’accusé dans sa fonction d’être humain est la plus grande.
Aujourd’hui, la justice en matière de violences
sexuelles est très décriée. Qu’en pensez-vous ?
La justice a longtemps dysfonctionné en la matière,
traitant ces affaires de façon trop désinvolte. Progressivement, la loi
autorisant la pilule ou la loi Veil sur l’IVG ont changé la donne. Le viol a
été redéfini en 1980. Le vrai problème, c’est la manière dont les femmes
violées ou battues sont accueillies dans les commissariats ou par la justice.
Les circuits fonctionnent mal et l’encombrement de l’institution judiciaire
rend les délais de jugement déraisonnables. Les difficultés à faire la preuve
sont consécutives à cette négligence, le manque de confiance en la justice fait
que les plaintes et les audiences sont trop tardives. Mais aujourd’hui le
nombre de faits jugés et la lourdeur des condamnations ne cesse de croître.
=====
Mediapart - BILLET DE BLOG 27 AVR. 2023
La LDH renforcée et combative dans une période de turbulences
La liberté associative est quant à elle menacée par le risque de suppressions arbitraires des subventions accordées aux associations. (...) C’est pourquoi, face à un tel danger, la LDH a sonné l’alarme et appelle celles et ceux qui entendent défendre notre modèle démocratique à s’engager à ses côtés avec détermination.
Patrick Baudouin Président de la LDH (Ligue des droits de l'Homme)
La première
salve est venue sans surprise du ministre de l’Intérieur. Auditionné le 5 avril
2023 au Sénat sur la manifestation contre la mégabassine de Sainte-Soline,
Gérald Darmanin a indiqué que les subventions accordées à la LDH méritaient
d’être regardées « dans le cadre des actions qui ont pu être menées ».
Cette menace voilée, d’une particulière gravité, faisait suite à toute une
série de critiques infondées développées par lui. Le reproche a ainsi été
formulé à la LDH d’avoir contesté un arrêté de la préfète des Deux-Sèvres
interdisant le port d’armes. Or, d’une part, il n’est pas besoin d’un arrêté
sur ce point puisqu’il s’agit d’un délit réprimé par un article existant du
Code pénal, et d’autre part le recours visait l’interdiction également prévue par
l’arrêté « d’armes par destination », en méconnaissance d’une
décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 ayant refusé l’extension
a priori de la notion d’arme à tout objet pouvant être utilisé comme
projectile. Le ministre de l’Intérieur mettait ensuite en cause la présence à
Sainte-Soline de membres des observatoires des pratiques policières et des
libertés publiques, qui ont pour mission de documenter les éventuelles dérives
des forces de l’ordre, alors que le droit international, comme d’ailleurs le
Conseil d’Etat, en consacre l’existence et la nécessaire protection lors des
manifestations. C’est ainsi que la LDH a, avec beaucoup d’autres organisations,
pu dénoncer l’usage disproportionné de la force par la gendarmerie avec
notamment le recours de façon indiscriminée et massive à des armes de guerre
tels que les LBD (lanceurs de balles de défense) ou les grenades de
désencerclement de type dangereux GM2L. Mais la virulence de la réaction du
ministre de l’Intérieur tient surtout au fait qu’après avoir soutenu que les
allégations de la LDH sur l’interdiction de porter secours en temps voulu à un
manifestant blessé en danger de mort étaient mensongères, ses propos ont été
démentis par la production d’un enregistrement audio démontrant la véracité du
retard dénoncé pour permettre l’accès du Samu à la zone concernée, parfaitement
accessible.
Pourtant,
alors qu’aucun des griefs ainsi avancés à l’encontre de la LDH ne résistait à
l’examen, une seconde salve, plus surprenante, et encore plus inquiétante, est
venue de la Première ministre. Elisabeth Borne, dont on aurait pu espérer si ce
n’est de désavouer son ministre de l’Intérieur qu’elle en tempère au moins les
propos, a en effet affirmé le 12 avril au Sénat, lors d’une séance de questions
au gouvernement, qu’elle ne comprenait plus certaines des prises de position de
la LDH, faisant mention, outre de la contestation de l’arrêté sur le port
d’armes, de son incompréhension sur certaines « ambiguïtés face à
l’islamisme radical ». La Première ministre va ainsi plus loin que G.
Darmanin puisqu’elle n’hésite pas à s’approprier une des accusations
récurrentes assez odieuse, faite d’amalgame et de contre-vérités, formulée par
les contempteurs de la Ligue pour tenter de la discréditer. Non, madame Borne,
il n’y a aucune ambiguïté par rapport à l’islamisme radical, et vous le savez
fort bien. Les valeurs que nous défendons depuis toujours, à savoir liberté,
égalité, fraternité, dignité humaine vont complètement à l’encontre de ce que
véhicule l’islamisme radical. En revanche, notre boussole n’est rien d’autre
que le respect des droits pour tous et toutes tels que définis par la
Déclaration universelle des droits de l’Homme. C’est à ce titre par exemple que
sans approuver le port du voile, nous rejetons une interdiction
contreproductive pour laisser la femme libre, ici et en Iran ou ailleurs, de le
porter ou non. Nous défendons pour les personnes accusées d’islamisme radical,
comme pour les terroristes ou les assassins, le droit à être jugés
équitablement. Il en va de même des droits dont doivent bénéficier les détenus,
les étrangers, les migrants. La lutte contre toutes les formes de
discrimination et de xénophobie, sans sélectivité, reste au cœur de notre
engagement. Si combattre l’islamophobie nous paraît une impérieuse nécessité,
ce n’est pas, contrairement à une petite musique insidieusement distillée, pour
délaisser le combat plus que jamais nécessaire contre l’antisémitisme, celui-là
même qui a été à l’origine de la Ligue et en parcourt toute l’histoire. Mais
nous réaffirmons, au regard de la motivation réelle de nos détracteurs, que le
droit international s’applique à tous les Etats, y compris celui d’Israël qui
ne doit pas faire exception, et si l’existence et la sécurité de ce pays
doivent être affirmées et protégées sans aucune réserve, il lui appartient de
respecter enfin les résolutions des Nations unies violées depuis plus de
cinquante ans quant à la cessation de l’occupation et de la colonisation, comme
de mettre un terme aux violations de plus en plus inadmissibles des droits des
Palestiniens.
Tels sont quelques-uns des
nécessaires éléments de réponse à apporter sans relâche aux attaques de G.
Darmanin et de E. Borne à l’encontre de la LDH. Cependant, il ne faut pas se
dissimuler que l’essentiel est ailleurs. Outre qu’il s’agit largement d’une
manœuvre de diversion pour essayer de détourner de la grave crise sociale et
politique que connaît la France et à laquelle n’est apportée qu’une réponse
répressive, c’est bien le sort de nos libertés qui est en question. Le
caractère structurel des violations policières illégitimes dénoncées par la
Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) constitue une
entrave certaine à la liberté de manifester. La liberté associative est quant à
elle menacée par le risque de suppressions arbitraires des subventions
accordées aux associations. Couper les vivres à celles-ci représente un des
éléments constitutifs de la politique des régimes illibéraux et autoritaires.
C’est pourquoi, face à un tel danger, la LDH a sonné l’alarme et appelle celles
et ceux qui entendent défendre notre modèle démocratique à s’engager à ses
côtés avec détermination. Le formidable élan de solidarité dont la LDH
bénéficiait depuis sa mise en cause par les plus hautes autorités de l’Etat n’a
fait que renforcer sa combativité pour parvenir à cet objectif. La LDH garde le
cap avec constance : la défense de l’Etat de droit.
=====
Médiapart - Billet
de blog 20 avr. 2023 - Gilles Manceron
Quand Le Figaro s’en prend à l’antifascisme de la LDH
L'article du Figaro « Quand la LDH excusait les
procès staliniens » prolonge l’offensive de Gérald Darmanin et de la Première
ministre, Elisabeth Borne, contre la Ligue des droits de l’Homme. En cherchant
cette fois dans son passé des raisons de la dénigrer, et sans tenir compte de
sa préoccupation essentielle dans la période du Front populaire de rassembler
toutes les forces contre le péril nazi.
L’article de Guillaume Perrault intitulé «
Quand la LDH excusait les procès staliniens » paru dans Le Figaro du 18
avril 2023 tente d’alimenter l’offensive contre la Ligue des droits de l’Homme
lancée par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et reprise par la
Première ministre, Elisabeth Borne, en essayant cette fois de trouver dans le
passé de cette association de nouveaux arguments pour la dénigrer.
Il s’agit de sa réaction face aux scandaleux Procès de Moscou qui se sont
succédé entre août 1936 et mars 1938 dans l’URSS de Staline à propos de
laquelle des auteurs avaient déjà mis en cause la LDH comme, plus généralement,
la gauche française lors du Front populaire. Le Figaro y reprend les
arguments déjà développés en 1984 par Christian Jelen dans son livre L’Aveuglement.
Les socialistes et la naissance du mythe soviétique, et reprises en 1995,
par François Furet, dans Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée
communiste au XXème siècle. Les mêmes accusations à l’emporte-pièce ont été
répétées en 2013 dans le Dictionnaire historique et critique de
l’antiracisme dirigé par Pierre-André Taguieff (PUF), par une notice sur la
LDH de Max Lagarrigue qui avait aussi été l’auteur en 2006 de l’article, « D’un
totalitarisme à l’autre… Les liaisons dangereuses de la Ligue des droits de
l’Homme », dans la revue éphémère, Le Meilleur des mondes, créée pour
défendre l’intervention des Etats-Unis en Irak.
La LDH ayant eu la bonne idée de documenter, grâce à ses Observatoires des
libertés publiques, le comportement abusif de certains éléments des forces de
police ou de gendarmerie lors des manifestations du 25 mars contre la
mégabassine installée à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, Gérald Darmanin a
incité les institutions et les collectivités locales à cesser toute subvention
à cette association qui ne cesse depuis cent vingt cinq ans de s'efforcer de
défendre les droits de l’Homme et fait l'objet d'une reconnaissance mondiale.
Elisabeth Borne a essayé d’élargir l'attaque en accusant de verser dans
l’antisémitisme cette association qui s’attache pourtant à opérer une
distinction rigoureuse entre la critique fondée sur le droit international de
la politique des gouvernements de l’Etat d’Israël et les dérives antisémites
qui rejaillissent y compris lors des mouvements de solidarité avec le peuple
palestinien. Cette fois, dans la suite de cette offensive lancée par Darmanin
contre la LDH, Le Figaro va chercher de nouveaux arguments pour la
dénigrer les positions qu'elle avait prises dans la période qui suivait
l’accession de Hitler au pouvoir en Allemagne et où les persécutions
antisémites et la politique expansionniste du Reich laissaient craindre les
horreurs que connaîtra l’Europe lors de la Seconde guerre mondiale et
constituaient sa principale préoccupation.
Le Figaro reprend dans cet article les mêmes accusations inexactes
proférées par ces auteurs contre la LDH, lui reprochant, sous prétexte
d’antifascisme, d’avoir adopté dans l’entre-deux-guerres une attitude
prosoviétique. Rien de plus inexact car elle a dénoncé avec force la prise du
pouvoir par les bolcheviks en Russie après leur coup d’Etat réussi d’octobre
1917. En mars 1919, à la suite d’une commission d’enquête qu’elle a constituée
le 28 novembre 1918 après la dissolution de l’Assemblée constituante par les
bolcheviks, elle a, tout en s’opposant aux interventions étrangères contre
l’URSS, condamné fermement leur régime et ses atteintes à la démocratie. Dans
sa revue, Les Cahiers des droits de l’homme, l’historien Alphonse Aulard
écrit en janvier 1920 un article intitulé « Le bolchevisme et la France »
expliquant que les bolcheviks n’étant pas élus comme l’avait été en 1792 en
France la Convention nationale, ils ne représentaient pas le peuple russe. Et
dans la même revue, un article d'Henri Guernut intitulé « Le problème russe et
la Ligue des droits de l’Homme » publié le 5 février 1920 appelait tous les
démocrates hostiles à la tyrannie à s’opposer au bolchevisme.
Cette position a scandalisé la Section française de l’Internationale
communiste (SFIC), le jeune PCF, qui a introduit en 1925 dans les cartes de ses
adhérents, un volet que tous devaient signer comportant un engagement de non
appartenance à la Ligue des droits de l’Homme. Et quand, en 1923, la LDH a
créé, avec une association allemande, la Fédération internationale des droits
de l’Homme (FIDH), les représentants russes qui y ont siégé jusqu’en 1938 ont
tous été des opposants en exil au pouvoir soviétique. C’était le cas en particulier
du juriste Boris Mirkine-Guetzévitch, qui a fait partie en 1935 de la
commission créée par la LDH pour enquêter sur les Procès de Moscou et composée
aussi du président de la Ligue, Victor Basch, et de l’avocat qui était l’un des
conseillers juridiques de l’association sans faire partie de ses responsables
élus dans ses instances, Raymond Rosenmark.
Mais celle-ci n’est pas parvenue à un consensus et ses conclusions
présentées le 18 octobre 1936 devant son comité central par le seul Raymond
Rosenmark ne peuvent être présentées comme validées par l’association. Son
rapport contient des phrases choquantes, qui créditent la culpabilité des
accusés à partir de leurs seuls aveux obtenus sous la torture : « Si Dreyfus
avait fait des aveux, est-ce que la Ligue se serait dressée pour sa défense
comme elle l'a fait ? ». La jurisprudence et la doctrine de tous les pays font
de l'aveu public, selon lui, « une preuve définitive de culpabilité ».
Victor Basch, qui aurait souhaité que la commission d’enquête entendent le fils
de Trotsky, Léon Sedov, n’a pas souscrit à ce rapport et a dit son « trouble »
et ses « angoisses » devant le bureau de la LDH qui a validé néanmoins la
présentation du rapport Rosenmark au comité central. Un autre membre de cette
instance, très populaire dans l'association, Félicien Challaye, a souligné a
contrario que les condamnés « ont été brisés par une longue instruction
préalable », que leurs aveux ne signifient rien et a estimé que la LDH doit
protester avec la plus grande énergie.
La discussion s’est achevée sans vote. Victor Basch déclare que l'enquête
n'est pas close, qu'elle n'est que suspendue. Il reconnait que Rosenmark n'a
envisagé que la dimension juridique, dans un rapport incomplet et provisoire qu'il
qualifie d'« avant-rapport ». Mais les Cahiers des droits de l'homme publient
le 15 novembre 1936 le rapport Rosenmark et un article qui dénonçait sa cécité,
soutenu par dix membres du comité central, est refusé. Au congrès suivant, à
l'été 1937, Félicien Challaye conteste de nouveau que des aveux extorqués sous
la torture constituent une preuve : « Si un dictateur m'avait emprisonné, s'il
exigeait de moi des aveux et, au cas où je m'y refuserais, menacerait
d'assassiner mon fils après l'avoir torturé, j'avouerais n'importe quoi ! ». Il
présente une motion qui « regrette que depuis dix mois la Ligue se soit en fait
abstenue de chercher la vérité sur ce que tant d'hommes en tous pays
considèrent comme une monstrueuse parodie de justice », elle n'obtient que 258
mandats (58 abstentions) contre 1 088 à celle qui donne quitus au comité
central. Mais ce vote s'explique par la volonté des Ligueurs de rassembler tous
les Etats et toutes les forces politiques, y compris l'URSS et les communistes,
susceptibles de s'opposer au projet nazi.
Il est clair qu’avec le recul du temps et avec ce que l’on sait des procès
staliniens, cette prise de position de la LDH face aux Procès de Moscou a été
défaillante eu égard aux règles de droit dont elle faisait sa référence. Dans
sa lettre de démission du comité central, Maurice Paz écrit le 27 juin 1937 : «
Ce sera à l'avenir un sujet d'étonnement que la Ligue n'ait pas trouvé d'autres
accents publics que ceux du rapport de notre collègue Rosenmark pour
caractériser la parodie sans doute la plus monstrueuse qu'aient enregistrée les
annales judiciaires ».
Mais le contexte des années 1933 à 1939 doit être restitué (1). La LDH se
mobilisait en 1936 pour l'aide aux républicains espagnols qui combattaient
depuis le coup d'Etat franquiste de juillet, quitte à ce qu'elle affronte sur
ce point le gouvernement de Léon Blum, et l'antifascisme et la mobilisation
contre le nazisme étaient ses préoccupations essentielles.
L'article de l'historienne Madeleine Rebérioux sur ce sujet, que la revue
que la LDH, Hommes & Libertés, a publié en 1998 à l'occasion de son
centenaire, est accompagné d'un encadré titré « L'impasse d'une analyse
strictement juridique » : « Il faut certes se replacer dans le contexte de
l'époque. Voir que tout ceux qui, dans les années trente, comprenaient que le
fascisme et le nazisme constituaient la menace principale pour les libertés en
Europe, et qu'il fallait préparer les démocraties à leur faire la guerre, en
déduisaient logiquement qu'il fallait regrouper à l'échelle internationale
toutes les forces susceptibles de s'y opposer, y compris l'URSS. Est-ce une
raison pour se faire berner par la parodie de justice que constituaient les
premiers procès de Moscou ? Si la Ligue des droits de l'homme a eu souvent des
prises de positions dont elle peut aujourd'hui être fière, ce n'est pas le cas
de ses conclusions de l'automne 1936 sur la validité des aveux et à la
culpabilité des accusés (1) ».
Mais cela ne justifie en rien que le quotidien Le Figaro cherche en
avril 2023 à rajouter une salve aux attaques inadmissibles proférées par Gérald
Darmanin et Elisabeth Borne contre le rôle démocratique que joue la Ligue des
droits de l'Homme.
En 1938, la direction de la LDH, celle de Victor Basch et d’Emile Kahn, a
privilégié à raison l’antifascisme et l’opposition au traité de Munich. C’est
un choix qui a conduit deux ans plus tard beaucoup de Ligueurs – tel Robert
Verdier (3) – à une participation rapide et active à la Résistance, alors que
nombre de personnalités véhémentes dans la critique de l’URSS sombreront dans
la Collaboration…
L’antinazisme était, pour la France et pour l’Europe, l’enjeu principal de
l’heure. Un enjeu que ne voulaient pas voir ceux qui, avec Le Figaro de
l’époque, refusaient de « mourir pour Dantzig » et disaient « plutôt Hitler que
le Front populaire »…
(1) Emmanuel Naquet, Pour l'Humanité. La Ligue des droits de l'homme de
l'affaire Dreyfus à la défaite de 1940, préface de Pierre Joxe, postface de
Serge Berstein, Presses universitaires de Rennes, 2014.
(2) Gilles Manceron, « L'impasse d'une analyse strictement juridique », dans
Hommes & Libertés, « 1898-1998. Une mémoire pour l'avenir »,
n°97/98, 1998, p. 47.
(3) Voir «
Robert Verdier ou quand la gauche s'est réinventée ». Blog de Mediapart, 2
septembre 2016.
La Ligue des droits de l’homme, mille et un chemins de la citoyenneté
Pierre Tartakowsky, président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme
raconte les conditions et les raisons de son adhésion à cette institution, à
l’heure où elle est attaquée.
Politis • 18 avril 2023 Article paru dans l’hebdo N° 1754
Après les attaques de Gérald Darmanin et Élisabeth Borne envers la
Ligue des droits de l’Homme, le premier s’interrogeant sur les subventions
versées à l’association, la seconde évoquant des « ambiguïtés », son président
d’honneur Pierre Tartakowsky retrace ici les conditions et les raisons de son
adhésion à cette institution.
Tout le monde connaît la
Ligue des droits de l’Homme (LDH). Enfin… Tout le monde croit la
connaître. C’est ce que je croyais moi-même, plus ou moins, avant. Avant d’y
adhérer, presque par accident. La Ligue ? Il y avait l’affaire Dreyfus, c’était
entendu. Pour le reste, cela évoquait une chimère assez
lointaine : mi-association, mi-institution, peuplée d’avocats et d’enseignants,
bref, pas pour moi.
Moi, je suis issu de la matrice communiste, de la CGT, où j’ai exercé toute
ma carrière comme journaliste d’information sociale ; d’Attac, à la fondation
de laquelle j’ai contribué. Alors, la Ligue, c’était tout à la fois trop
impressionnant, trop chargé d’histoire, trop sentencieux. Pas assez d’action,
non plus. Décidément pas pour moi.
La Ligue, c’était tout à la fois trop impressionnant, trop chargé
d’histoire, trop sentencieux.
Jusqu’à ce que je bute sur elle, en la personne de Michel Tubiana, lors d’un
covoiturage militant. Il s’agissait d’aller de Paris à Amiens – je crois
bien que c’était Amiens – pour un débat coorganisé par Attac et la Ligue
sur la tenue prochaine du sommet du G7 à Nice. La pluie tombait à verse et la
conduite de Michel avait tout pour inquiéter.
Il parlait d’abondance tout en regardant son interlocuteur, moi en
l’occurrence, bien plus souvent que la route. Je lui donnais la réplique et
suppliais en moi-même la providence de nous faire arriver à bon port. Le retour
se fit dans les mêmes conditions. Au moment de nous séparer, Michel m’informa
que j’adhérais à la LDH. La chose était à ce point évidente à ses yeux
qu’elle le devint aux miens.
Adhérer était simple, s’intégrer… L’engagement – syndical, associatif
ou politique – procède parfois d’une heureuse rencontre aux suites souvent
plus âpres. J’ai dû admettre au fil des ans que la Ligue, comme toute structure
de plus de cent ans, avait ses routines et ses routiniers, ses tics et ses
tocs, un passé sans cesse à réexplorer et un avenir à réinventer, encore et
encore.
C’est qu’être association généraliste de défense des droits a un prix :
c’est une folle diversité de priorités qui se
bousculent, s’épaulent ou se marchent sur les pieds. Cet aimable charivari
militant s’organise autour d’un mantra : « les droits sont universels et
indivisibles », qui prête à sourire, tant les formules toutes faites
minéralisent l’intelligence et pétrifient la vie. J’en ris moi-même souvent
tant elle sonne creux lorsqu’on l’abandonne à elle-même.
C’est là qu’opère la magie de la Ligue : son activité tous azimuts
transforme ce creux en trop-plein et de la diversité, elle fait convergence
autour de cette obsession commune de la défense des droits et des libertés.
Tous les droits et toutes les libertés, pour toutes et tous, ici et là-bas, où
que se situe ce là-bas.
Le résultat est vertigineux : la Ligue et ses sections,
c’est à la fois les négociations en Nouvelle-Calédonie et une intervention
pédagogique en milieu scolaire ; l’assignation en justice de Dieudonné et la
dénonciation de la prolifération de fichiers de police ; les manifestations
contre les insultes racistes à l’encontre de Christiane Taubira et
l’organisation de concours d’éloquence ; le soutien au processus de paix au
Pays basque et les observateurs dans les manifestations ; l’engagement contre
les activités sectaires et l’Observatoire de la liberté de création… C’est une
défense de chaque instant contre les attaques qu’ont subies ces dernières
décennies les libertés publiques et les droits
civils. C’est par-dessus tout le refus d’une raison d’État primant sur les
droits, qu’il s’agisse de ceux des détenus, des migrants, des enfants, des
laissés-pour-compte ou des discriminés.
Cet aimable charivari militant s’organise autour d’un mantra : « les droits
sont universels et indivisibles ».
Cela ne fait pas que des heureux : la LDH s’est vu successivement accusée
de rouler pour les juifs et les Allemands, les bolcheviks et les francs-maçons,
les « fellouzes » et les « ratons », les assassins, les pédophiles, les
terroristes, les islamistes… Bref, un concentré d’anti-France.
L’actuel ministre de l’Intérieur et la Première ministre prennent place dans
cette longue lignée de responsables
politiques tristes et ridicules acharnés à nous convaincre que la liberté est
un luxe, l’égalité une baudruche et la fraternité un mythe. Je les écoute
conforter mon engagement, à leur manière détestable et, chaque matin, je
remonte dans cette voiture roulant sous une pluie battante sur les mille et un
chemins de la citoyenneté.
=====
Patrick Baudouin, président de la LDH :« Les libertés publiques en France sont en péril »
En pleine polémique avec le gouvernement, le président de
la Ligue des droits de l’homme répond, dans un entretien au
« Monde », aux accusations de Gérald Darmanin et d’Elisabeth Borne.
Vidéo : LDH, vigie de la République ?
Soutiens et réactions
DEFENSEURE DES DROITS : "DES RISQUES D'ATTEINTES AUX DROITS ET LIBERTES QUI FRAGILISENT LA DEMOCRATIE"
Dans une démocratie représentative, le suffrage universel permet à tous les citoyens d’élire des représentants chargés d’exprimer la volonté générale.
Au-delà du système représentatif, la démocratie repose également sur des droits et libertés, tels que les libertés d’expression, de réunion, de manifestation et d’association, qui permettent notamment à ceux qui sont éloignés de la vie politique ou qui n’ont pas le droit de vote d’influencer la prise de décision collective.
Toute atteinte portée contre les droits et libertés, qui constituent l’un des piliers de la démocratie, peut conduire à fragiliser l’édifice.
Protégée par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la liberté d’association est un des principes fondamentaux d’une société démocratique. A l’instar de la liberté de communication, de réunion et de manifestation, elle permet l’expression dans l’espace public de la pluralité des opinions et des intérêts collectifs au sein de la société.
Les associations permettent à la société de rendre visible des problèmes ignorés par les institutions. En particulier, de nombreuses d’entre elles se sont structurées pour défendre et rendre audibles celles et ceux dont la voix est généralement trop faible pour être entendue.
Depuis plusieurs années, le Défenseur des droits dénonce un affaiblissement de cette liberté qui se manifeste de différentes manières, plus ou moins insidieuses.
Depuis 2016, l’institution déplore l’existence de pratiques d’intimidation des forces de l’ordre à l’encontre des associations de défense des plus précaires présentes sur le terrain lors des opérations d’expulsion des campements d’exilés[1]. Le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration comporte d’ailleurs, dans sa version issue du Sénat, un article 17 dont l’adoption aurait autorisé la fouille des véhicules des particuliers lorsqu’il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ». Les critères particulièrement vagues pour mettre en œuvre une telle fouille auraient permis aux forces de l’ordre de fouiller systématiquement les personnes soupçonnées d’être des membres d’associations d’aides aux exilés.
A l’occasion de l’adoption de la loi confortant le respect des principes de la République, le Défenseur des droits a également dénoncé la restriction de la liberté d’association que constitue le conditionnement de l’attribution de subventions à la signature d’un « contrat d’engagement républicain ». Ce contrat n’exige plus seulement des associations qu’elles ne commettent pas d’infraction, mais aussi qu’elles s’engagent positivement et explicitement, dans leurs finalités comme dans leur organisation, sur des principes qui sont ceux de la puissance publique. Un tel renversement dénature en partie le statut des associations, qui ne sont pas des acteurs publics, et autorise un contrôle très poussé de l’État sur les actions des associations[2]. Sur ce fondement, dans le département de la Vienne, le Préfet a sollicité le rappel des subventions versées à l’association ALTERNATIBA Poitiers affectées à l’organisation d’un festival, pour le motif que s’y serait tenu un atelier relatif à la désobéissance civile.
Enfin, il faut rappeler que cette même loi a facilité la dissolution d’associations en permettant de leur attribuer la responsabilité d’agissements commis par un de leurs membres agissant en cette qualité, si elles en ont connaissance et se sont abstenues de les faire cesser. Ce dispositif fait peser une obligation de contrôle des membres de ses membres particulièrement lourdes pour une association petite et peu structurée[3].
La Cour européenne des droits de l’homme estime que la stigmatisation d’associations par les autorités publiques, combinée à la menace de mesures de contrôles et de sanctions, peut porter atteinte à la liberté d’association[4]. Ces phénomènes réduisent la marge de manœuvre des associations en les intimidant, les exposent à des difficultés financières et humaines et peuvent provoquer leur dissolution.
La Ligue des droits de l’Homme, constituée en défense du capitaine Dreyfus, et qui depuis sa reconstitution après sa dissolution par le régime de Vichy a agi en faveur des droits des femmes, des peuples colonisés, des exilés ou des personnes les plus précaires, a fait l’objet d’une telle stigmatisation par des responsables politiques.
En premier lieu, la légitimité des recours formés par la Ligue des droits de l’Homme dans le cadre des manifestations à Sainte-Soline et notamment le recours formé contre l’arrêté préfectoral qui empêchait les transports d’armes en considérant que la définition retenue par l’arrêté de la notion d’arme était trop vague a été contestée car menaçant la sécurité publique. Outre le fait que dans un État de droit toute décision publique doit pouvoir être contestée devant des juridictions, estimer qu’une association de défense des libertés publiques menace la sécurité revient à la faire basculer dans le champ des associations contre lesquelles des mesures coercitives peuvent être déclenchées.
En second lieu, une suspension des subventions accordées par l’État et par les collectivités territoriales à la Ligue des droits de l’Homme a été évoquée. Ce faisant, une telle mention valide implicitement l’idée selon laquelle la Ligue des droits de l’Homme pourrait remettre en cause gravement l’État au point de pouvoir justifier la suppression de subventions, notamment par des collectivités locales.
En outre, les subventions publiques accordées à la Ligue représentent 29% de son budget : un retrait de ces subventions pourrait conduire à une réduction substantielle de son activité.
Par conséquent, le Défenseur des droits constate, à travers les réclamations qu’il reçoit, une intensification des risques d’atteintes à la liberté d’association. Une telle évolution est hautement problématique dans un État démocratique.
Le Défenseur des droits peut être saisi par une personne physique ou une personne morale, comme une association, ayant fait l’objet d’une mesure défavorable pour s’assurer, au moyen de ses pouvoirs d’instruction, que les règles de droit et les procédures ont bien été respectées.
[1] Les droits fondamentaux des étrangers en France, 2016.
[3] Idem.
[4] Cour EDH, 14 juin 2022, Ecodefence and others v. Russia, req. n°998813 et autres.
« Attaquer la Ligue des droits de l’homme, c’est miner notre fraternité » Le Monde Tribune
Nous n’avons pas
besoin de désigner des cibles mais de retisser les fils d’un commun,
soulignent, dans une tribune au « Monde », trois universitaires
spécialistes de l’islam, Kahina Bahloul, Steven Duarte et Haoues Seniguer,
indignés des accusations de complicité avec l’islamisme radical portées contre
la Ligue de droits d’homme.
Publié le 24
avril 2023 à 15h00, modifié le 24 avril 2023 à 22h36
Gérald
Darmanin, ministre de l’intérieur et des cultes, puis Elisabeth Borne, première ministre, ont désormais
marqué l’histoire en attaquant frontalement la Ligue des droits de l’homme
(LDH). Ils l’accusent notamment de faire la courte échelle à « l’islamisme
radical », ou de cultiver des « ambiguïtés » à son
égard, ce qui revient insidieusement au même.
Aucun autre
exécutif depuis la Libération n’avait jamais osé attaquer, en des termes aussi
crus, la vigie des droits humains que représente la LDH depuis sa création à l’occasion
de l’affaire Dreyfus.
En d’autres
circonstances, cela aurait pu prêter à sourire mais, hélas, cette diatribe
venant des plus hautes sphères de l’Etat tombe à un très mauvais moment. La
ficelle est grosse. Elle est en tout cas le symptôme d’une forme de
radicalisation du pouvoir en place, qui devrait plutôt s’inquiéter du fait que
les informations d’Amnesty International sont de plus en plus
fréquemment consacrées à l’actualité française. Surtout lorsque ce pouvoir a
été en grande partie réélu pour « faire barrage » à l’extrême droite.
Au vu des prétentions affichées, vérifions cependant qu’il s’agit bien d’un
barrage et non d’un toboggan.
Ce n’est pas
la première fois que le gouvernement flirte avec les mots au sujet de ses
supposés adversaires.
Stupeur du monde universitaire
Rappelons la
polémique sur le prétendu « islamo-gauchisme », devenu
slogan politique pour réactionnaires de tout poil sur les plateaux de
télévision. En février 2021, en pleine pandémie de Covid-19 et
pendant que les enseignants et les personnels administratifs se préoccupaient
de maintenir coûte que coûte la continuité pédagogique d’étudiants déjà fort
éprouvés par une indécente précarité, l’ancienne ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal, avait en effet
suscité la stupeur du monde universitaire en
prétendant que « l’islamo-gauchisme (…) gangrène la société dans
son ensemble » et que « l’université n’est pas
imperméable » à ce phénomène.
Répétons-le ici, l’« islamo-gauchisme » ne correspond à aucune réalité mesurable. C’est un mot hochet spécieux entre les mains d’esprits autoritaires, qui ne sert qu’à disqualifier.
Vint ensuite
la loi contre le « séparatisme » (devenue loi confortant le
respect des principes de la République) qui a consacré une politique exacerbée
du soupçon envers la visibilité de l’islam pratiquant, pour de bien maigres
résultats, mais au coût élevé quant à la stigmatisation d’une population lasse
de voir sa religion au centre de toutes les polémiques, alors qu’elle contribue
non moins que d’autres à faire vivre ce pays quotidiennement.
Sans parler
des dommages collatéraux qui obligent désormais toutes les associations du pays
à signer une charte des valeurs lorsqu’elles demandent une subvention. Quid
d’une association royaliste pour qui l’idée de République est une
aberration ? Quid d’une démocratie (nominale ?) qui ne tolère pas
qu’on la remette en cause, même pacifiquement ?
Insupportable instrumentalisation
Dernier fait
en date, l’amalgame suspicieux entretenu entre le phénomène de
l’« islamisme radical » et une association historique de défense des
droits humains. Ne nous payons pas de mots, il s’agit bien ici d’une
insupportable instrumentalisation. La critique par la LDH du maintien de
l’ordre lors des manifestations à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) n’a pas plu à
l’exécutif, mais celui-ci, plutôt que de s’en prendre au lanceur d’alerte,
ferait mieux d’examiner l’alerte elle-même et ce qu’elle signifie.
Essayer de
faire taire toute critique en criminalisant ses oppositions, en utilisant
l’accusation facile de collusion avec un supposé « islamisme
radical », dont les contours ne sont jamais établis, interroge sérieusement
sur les fondements d’une telle attitude. En réalité, le présupposé de départ
est faux. L’exécutif semble prêter une oreille attentive au point de vue de
« l’école Gilles Kepel », ce chercheur postulant l’idée d’un fatal
continuum entre islam politique, islamisme et djihadisme.
L’exécutif
semble prêter une oreille attentive au point de vue de « l’école Gilles
Kepel », ce courant de recherche postulant l’idée d’un fatal continuum
entre conservatisme religieux, islamisme et djihadisme ; raison pour
laquelle toute défense d’une association militante de l’islam, même
parfaitement légaliste, sera taxée de complicité avec « l’islamisme
radical ».
Or ces mots
sont piégés et dangereux. La thèse de départ est scientifiquement fragile et
les discours qui en découlent nourrissent, consciemment ou non, la stratégie
des djihadistes qui ont ensanglanté notre pays : casser la société entre
citoyens musulmans et non musulmans, nourrir une pseudo-guerre
civilisationnelle, inciter à une guerre civile, etc.
Qu’un Eric
Zemmour reprenne sciemment cette vision manichéenne et dangereuse du monde
n’est guère étonnant, mais que des ministres d’un gouvernement, voire quelques
universitaires se targuant de lutter contre ces extrémismes, entretiennent le
poison du soupçon en désignant des ennemis intérieurs, c’est proprement
glaçant. C’est de surcroît inefficace car seule l’extrême droite en tirera des
bénéfices électoraux.
Poussées autoritaires
Cette pente
autoritaire ne concerne d’ailleurs pas seulement la question de l’islam, elle
est diffractée dans la gestion d’autres dossiers, tels que le traitement des
mobilisations des « gilets jaunes » dès 2018, où la brutalité
répressive fut exercée çà et là contre des manifestants loin d’être dans leur
majorité des « casseurs ».
Quel que soit
le lieu d’observation choisi, on constate de multiples indices concordants de
poussées autoritaires venant d’un exécutif qui reste réfractaire à l’écoute
empathique de secteurs significatifs du peuple sur des questions majeures de
société. Dans ce contexte, écartés de l’élaboration des décisions qui les
concernent, les citoyens ne peuvent se sentir à la fois « auteurs et
destinataires du droit », pour reprendre les mots du philosophe
allemand Jürgen Habermas.
Notre devise
nationale en devient orpheline, car attaquer la LDH, c’est miner notre
fraternité. Celle-ci se perd en chemin par ces attaques réitérées visant des
pans entiers de notre communauté nationale : contre de simples citoyens
luttant pour leur pouvoir d’achat, contre des militants associatifs musulmans
aspirant à participer positivement à la collectivité au nom de leur foi (ou
non), contre de futurs ou actuels retraités refusant massivement une réforme
discutable.
Or nous
n’avons pas besoin de désigner des cibles, mais de retisser les fils d’un
commun. Nous n’avons pas besoin d’unanimisme, mais d’entretenir du lien social
dans un réel esprit de concorde. Nous n’avons pas besoin d’attiser les peurs,
mais de recréer les conditions de la confiance et de l’espérance. Nous n’avons
pas besoin d’uniformité, mais d’accueillir la différence et l’altérité en leur
reconnaissant richesse et fécondité qu’elles apportent à notre humanité.
Liste des
signataires : Kahina Bahloul, Islamologue,
doctorante au Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM), campus
Condorcet, imame libérale, autrice de « Mon islam, ma
liberté » (Albin Michel, 2021) ; Steven Duarte, maître de
conférences en arabe et en islamologie à Sorbonne-Paris-Nord, laboratoire
Pléiade, spécialiste des réformismes de l’islam ; Haoues Seniguer, maître
de conférences des universités en science politique à Sciences Po Lyon,
chercheur au laboratoire Triangle, Lyon.
======
Atteintes aux libertés : le monde associatif pris d’effroi
Qu’elles soient
mobilisées contre le racisme, la pauvreté ou pour l’écologie, les associations
sont en ébullition depuis que l’exécutif s’est attaqué à la Ligue des droits de
l’homme. Les restrictions aux libertés, en réalité, s’aggravent en coulisses depuis
la loi « séparatisme ». Huit organisations confient leurs inquiétudes
sur la dérive du pouvoir.
20 avril 2023 à 19h48
L’alerte est inédite. Depuis quelques jours, la Défenseure des
droits, Claire Hédon, nommée par Emmanuel Macron, multiplie les prises de
parole pour s’alarmer des « risques
d’atteintes aux droits et libertés » en France, de ceux « qui fragilisent la démocratie » (elle
est ce jeudi soir l’invitée spéciale de notre émission « À l’air
libre »).
Après les attaques
ou menaces récemment proférées par le ministre de l’intérieur contre la
Ligue des droits de l’homme (LDH), les Soulèvements de la Terre, Alternatiba ou
des organisations d’aide aux migrant·es, cette autorité indépendante pointe « une intensification des risques d’atteintes » à
la liberté d’association et son « affaiblissement ». « Une telle évolution est hautement
problématique dans un État démocratique », lance-t-elle.
Dans son viseur, entre autres : la loi « séparatisme » de 2021, voulue par le chef de l’État lui-même, qui a conditionné l’attribution de subventions à la signature d’un « contrat d’engagement républicain » ou facilité les procédures de dissolution. Ce texte se révèle une arme lourde contre la société civile qui dérange le pouvoir, bien au-delà des organisations accusées de faire le jeu de l’islamisme radical. « Nous avons l’impression d’avoir été le patient zéro de cette politique », cingle aujourd’hui Marwad Muhammad, ex-président du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF).
Mediapart donne la parole à huit associations inquiètes, qu’elles soient mobilisées contre le racisme ou la pauvreté, en défense de l’écologie ou des droits des étrangers et étrangères : comment qualifier la dérive de l’exécutif ? Se sentent-elles entravées dans leurs activités ? Voire en danger ?
Kaltoun Gachi, vice-présidente du Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
« Ce qui est
arrivé à la LDH, ce que dénonce la Défenseure des droits – mais la
CNCDH [Commission nationale consultative
des droits de l’homme] n’est guère plus tendre –, est
exceptionnel. Nous dénonçons cette remise en cause des actions et de la parole
des associations qui luttent pour les libertés publiques, et nous défendons une
liberté d’expression, d’opinion, qui protège les citoyens et peut-être encore
plus les associations de lutte contre la violation des droits humains. Il doit
régner une forme d’égalité, de transparence dans l’attribution des subventions,
et pas simplement car nous serions ou non dans la ligne du pouvoir.
Cette petite incise
de Gérald Darmanin [à l’encontre de la
LDH – ndlr] aurait pu passer inaperçue, mais au contraire la
première ministre a enfoncé le clou. C’est inquiétant d’un point de vue
général, c’est évident ; mais pas pour le Mrap en lui-même, pour le
moment. Bien sûr, quand on tient de tels propos, on peut s’attendre à tout...
Ce qui est arrivé a produit l’effet
inverse peut-être de celui espéré : nous sommes révoltés, et ce n’est
sûrement pas ces menaces aux subventions qui réussiront à nous museler. Il y a
déjà des subventions que nous n’obtenons pas, pour nos prises de position
internationales notamment. Sur le conflit israélo-palestinien par exemple, nous
avons une position qui est celle de dénoncer les exactions commises par le
gouvernement israélien. Parfois, on en paye le prix fort. C’est aussi une
question d’indépendance.
La loi « séparatisme » a marqué un tournant, selon nous, et un début de chasse aux sorcières. Ce qui est assez symptomatique, c’est que dès qu’on exprime une opinion qui n’est pas celle attendue par le pouvoir, on vous qualifie d’“islamogauchiste”. Moi, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Sauf à vouloir stigmatiser une personne avec laquelle on est en désaccord. »
Marwad Muhammad, ex-président du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF)
« Nous avons l’impression d’avoir
été le patient zéro de cette politique. Celui sur lequel on expérimente tout.
On l’avait d’ailleurs dit à l’époque aux autres associations : si vous ne
bougez pas maintenant, vous serez les prochaines sur la liste.
Dans notre cas, comme souvent, le
gouvernement a commencé par nous salir publiquement. Cela a commencé par des
déclarations de Gérald Darmanin sur France Inter affirmant que le CCIF aurait
participé à la campagne qui a conduit à l’assassinat de Samuel Paty. Ce n’est
qu’après qu’il a demandé à ses services de rendre notre dissolution possible
légalement.
Finalement, l’éléphant raciste a
accouché d’une souris administrative et le motif retenu au bout du compte pour
la dissolution n’avait plus rien à voir avec les accusations initiales. Il
suffisait de dénoncer l’islamophobie pour devenir “séparatiste”.
Ce qui a volé en éclats pour moi, à ce
moment-là, était la conviction que nous avions des institutions d’un État de
droit qui ne permettraient pas notre dissolution. En fait, ces institutions,
censées être les garde-fous des droits fondamentaux, étaient mises en état de
choc avec ce contexte particulier de la menace terroriste.
Avec le recul, je me dis que c’était plus facile de commencer par nous que par la LDH. Nous étions une association de lutte contre l’islamophobie, avec beaucoup de Noirs, d’Arabes… Le plus frappant a été de constater le silence de ceux avec qui nous avions manifesté et qui ont soudain perdu l’usage de la parole. »
Antoine Sueur, président d’Emmaüs
« Nous avons apporté notre
soutien à la Ligue des droits de l’homme car une société a toujours besoin de
gens qui nous percutent et qui nous interrogent. Symboliquement, politiquement
et philosophiquement, cette attitude est très inquiétante parce que ça veut
dire qu’on est prêts à toucher à ces domaines qui sont sacrés comme le respect
des droits humains.
Cette menace de suspension de
subventions contrevient à l’idée associative. Ce n’est pas parce qu’on est un
associatif qu’on doit absolument absorber et intégrer les volontés de la
politique de l’État, quelle qu’elle soit. Surtout que les associations et les
réseaux de soutien solidaires remplissent des missions que l’État n’a pas du
tout la capacité de faire. Il serait donc révoltant que tout le réseau
associatif qui apporte ce plus soit suspendu aux bonnes volontés de l’État.
Il nous semble aussi que laisser
passer ça ouvre la porte à beaucoup d’autres dérives autoritaires. Elles nous
guettent déjà avec l’utilisation du 49-3 et cette radicalisation du pouvoir
dans la répression des manifestations. Ce n’est plus l’apanage de la Pologne,
des États-Unis, du Brésil et de tant d’autres lieux où les chefs d’État ne
veulent pas s’encombrer de contre-pouvoirs. Et ça, c’est dramatique parce
qu’une société saine, c’est une société qui discute et n’envisage pas le
rapport entre les marges en imposant par le haut sa volonté.
Donc c’est maintenant qu’il faut tirer la sonnette d’alarme de façon vive et déterminée. »
Rémi Donaint, porte-parole de l’association écologiste Alternatiba
« Nous avons compris que, bien qu’étant une association prônant la
désobéissance civile non violente, ils trouveront toujours un moyen de nous
considérer comme violents. Il semble ne pas y avoir de limite à l’arsenal
répressif. Le risque de cette escalade, c’est qu’elle pèse sur l’engagement des
citoyens dans des actions militantes. La bonne nouvelle, c’est que nous
n’observons pas de baisse de cet engagement – au contraire.
Mais il y a la
crainte que les poursuites pour un rien se multiplient. Nous avons le cas de
trois décrocheuses de portraits [du
président Macron dans les mairies – ndlr] dont les procès se
sont tenus il y a un ou deux ans déjà, mais à qui la police est venue récemment
réclamer leur ADN. Elles ont refusé et risquent un nouveau procès.
Vers fin 2023-début
2024, il y aura également le procès lié à Alternatiba-Poitiers [le préfet de la Vienne a réclamé en septembre le
retrait d’une subvention au motif que l’organisation aurait violé son “Contrat
d’engagement républicain” en organisant un atelier de formation à la
désobéissance civile – ndlr]. Et nous avons déjà un nouveau cas,
à Besançon, d’un conseiller municipal qui demande le retrait d’une subvention
pour une autre formation à la désobéissance civile.
Nous sommes à la fois surpris et pas surpris par cette situation... Les mouvements de désobéissance civile comme le nôtre ont en tout cas l’habitude, dans ces contextes de répression, de rechercher la créativité, d’imaginer des actions qui se glissent dans les interstices de la réponse sécuritaire, sans trop nous exposer, ou avec le moins de risque possible. »
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l’association Droit au logement
« Au DAL, nous subissons déjà une
pression policière particulièrement forte depuis un an. Nous avons fait une
dizaine de recours devant les tribunaux contre des interdictions de
manifestation, et à chaque fois – sauf une – nous avons gagné. Notre
atout, c’est que nous ne dépendons d’aucune subvention publique, c’est un moyen
de pression en moins.
En plus, on se sent
visés directement par la loi dite “anti-squat”, qui crée un délit de “promotion du squat”, quel qu’en soit le mode,
et est passible de 3 750 euros d’amende. Donner des informations, conseiller
des personnes en situation de précarité ou qui occupent déjà un lieu, pourrait
tomber sous le coup de la loi. Notre boulot au DAL consiste à aider des gens
qui sont à la rue alors que les structures d’hébergement d’urgence sont
saturées. Je rappelle que condamner des gens à la rue, c’est souvent les
condamner à la mort...
On a vraiment l’impression que le gouvernement veut juguler les mouvements de mal-logés au moment où la crise du logement s’aggrave. Car cette loi vise aussi tout un réseau d’associations d’aide aux précaires. La manière dont le texte est rédigé pourrait également cibler les syndicats qui conseillent à leurs salariés une occupation de locaux, d’entrepôt par exemple. »
François Guennoc, membre de l’Auberge des migrants et ex-président
« Depuis 2014
déjà, on est entrés dans une phase où le dialogue est devenu impossible avec
les autorités. On a fait face à des accusations multiples venant des pouvoirs
publics : Gérard Collomb, ministre de l’intérieur, qui suggérait qu’on
aille “exercer notre talent ailleurs” ;
puis la mairie de Calais, qui nous a accusés de coopérer avec les passeurs et
de fournir des armes aux exilés. On a d’ailleurs songé à porter plainte pour
diffamation.
De plus en plus, on doit également
faire face à des formes d’entrave visant à empêcher notre action sur le
terrain, comme la série d’arrêtés préfectoraux venant interdire les
distributions alimentaires au centre-ville de Calais, les verbalisations qui
touchent nos salariés et bénévoles, l’interdiction de documenter les
évacuations de campements… On est aussi confrontés à des contrôles d’identité
incessants, pour nous intimider.
On n’est pas menacés, pour l’instant, par une dissolution ou une interdiction d’exercer nos activités, mais c’est vrai que quand on voit le contexte national, on est assez inquiets de voir que des digues sautent et que le gouvernement se montre aussi agressif à l’encontre de ses opposants. Ces pressions sur des associations sont très préoccupantes. »
Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace-France
« On est très
inquiets de ce qu’on voit, notamment de la part de Gérald Darmanin, qui vise à
disqualifier l’aspect confrontatif de la société civile. C’est dangereux :
le milieu associatif s’en retrouve décrédibilisé auprès du public. Je vois là
une vraie tentative de le déstabiliser. Dès lors que l’on commence à contester,
on sent bien que l’on n’est plus considérés comme citoyens. Pour l’instant, on
reste libres, notre quotidien n’a pas changé. Mais quand le ministre de
l’Intérieur nous taxe d’“écoterrorisme”, on
se dit qu’on est d’autant plus surveillés.
Depuis Macron, dès qu’on sort du cadre
fixé par le gouvernement, on prend par ailleurs le risque des gaz lacrymogènes
et des coups de matraque. Les dernières marches du climat, qui se sont mal
passées, ont tiré le trait sur la possibilité d’en faire des marches familiales
et intergénérationnelles. Et depuis quelques mois, oui, le climat a encore
changé. Certains parlementaires cherchent à renforcer des moyens de pression
sur les associations, comme avec la tribune proposant la suspension des
réductions fiscales sur les dons aux associations commettant des infractions.
Une proposition refusée mais qui aurait pu mettre Greenpeace en péril.
Seul point qui me rassure dans ce climat, c’est que la justice, malgré l’augmentation de la répression, tient bon jusque-là. »
Arnaud Veïsse, directeur général du Comité pour la santé des exilé·es (Comede)
« Le Comede
fait partie des nombreuses associations contraintes de signer le “contrat d’engagement républicain”, issu de la
loi “séparatisme”. Si nous refusons de le signer, nous perdons toutes les
subventions publiques, dont nous dépendons à 80 %. Or ce contrat n’en a
que le nom, puisqu’il nous est imposé par l’autre partie, l’État. Il nous
impose de respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, ce
qui nous va très bien. Seulement, nous considérons que l’autre partie ne les
respecte pas à l’égard des étrangers.
Par ce contrat,
nous nous engageons également à ne pas porter “atteinte
à l’ordre public”. Mais ce point est sujet à interprétation : nous
prodiguons des soins et défendons le droit à la santé des éxilé·es, qu’ils
soient en situation régulière ou irrégulière, y compris les débouté·es du droit
d’asile. Autre difficulté : nous dépendons de plus en plus de subventions
qui transitent par le ministère de l’intérieur et qui sont parfois ciblées vers
les seuls demandeurs et demandeuses d’asile. Or,nous refusons de faire des
discriminations.»
=====
L’appel
du monde associatif à soutenir la LDH : “Nous continuerons”
Communiqué
collectif de soutien à la LDH - 12.04.2023
Auditionné par la commission des lois du Sénat
sur les techniques de maintien de l’ordre à Sainte-Soline, en réponse à une
intervention du sénateur Bonhomme invitant à cesser le financement des
associations « qui n’ont rien à voir avec l’état de droit, quoi
qu’elles en disent », le ministre de l’Intérieur a estimé que la
subvention accordée à la Ligue des droits de l’Homme « méritait d’être
regardée dans le cadre des actions qu’elle a pu mener ».
Les dernières digues cèdent face au tournant
autoritaire emprunté par le ministre de l’intérieur.
Il n’hésite plus à s’attaquer à tous les acteurs
qui remettent en cause son action, jusqu’à s’en prendre à la LDH qui, depuis
des décennies, combat pour la protection des droits et libertés et des valeurs
démocratiques.
La Ligue des droits de l’Homme a été créée il y a
125 ans, au lendemain de l’affaire Dreyfus, par des esprits résistants en vue
de combattre l’injustice antisémite, elle a été de toutes les luttes
historiques contre le fascisme, pour la laïcité, pour la garantie des libertés
publiques et la reconnaissance de nouvelles. Jusqu’à ce jour, le seul régime à
avoir remis en cause son existence était celui de Vichy en 1940.
L’actualité la plus récente a rappelé l’utilité
de l’action de la LDH qui a, grâce à ses observateurs et observatrices, dénoncé
les dérives du maintien de l’ordre et l’entrave à l’intervention des secours
sur Sainte-Soline. La ligue a appelé à une désescalade de la violence, et se
trouve encore à l’origine avec plusieurs organisations et syndicats, des
récentes condamnations de préfectures, en raison de l’atteinte portée à la
liberté de manifestation.
La LDH est à l’origine de bien des avancées du
droit et des libertés avec des contentieux qu’elle a gagnés, devant le Conseil
constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Comme à son habitude, le ministre de l’Intérieur
ignore que le soutien financier aux associations n’implique pas que les
collectivités soient en accord avec l’ensemble des revendications ou des
positionnements politiques pris par l’association dans le débat public.
Une fois de plus, le ministre de l’intérieur fait
preuve de défiance à l’égard du monde associatif, en insinuant qu’il faut
réserver le bénéfice des subventions aux bons soldats, à ceux et celles qui
feront acte d’allégeance à la politique du gouvernement, sans remettre en cause
ses actions, sans dénoncer ses dérives, sans troubler l’ordre public.
La restriction des financements accordés aux
contre-pouvoirs et aux associations de défense des droits humains est
symptomatique du vacillement de l’Etat de droit. Les propos du ministre
confirment non seulement la menace qui pèse sur le tissu associatif, en
particulier depuis la mise en œuvre de la loi dite « séparatisme » du
24 août 2021, mais plus globalement sur les contre-pouvoirs et ceux qui prônent
une certaine idée de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit.
La rhétorique déployée par le ministre de
l’Intérieur est dangereuse et témoigne du basculement de ce dernier, et du
gouvernement auquel il appartient, dans l’illibéralisme autoritaire.
Le ministre sape le fondement même de l’idée
politique en disqualifiant toute opposition, la faisant désormais passer pour
du « terrorisme intellectuel ». Si vous n’êtes pas d’accord
avec G. Darmanin, vous êtes suspect.
Mais les tentatives de bâillonnement seront
vaines car, pour reprendre les termes du Président de la LDH, « nous
continuerons ».
Plus que jamais nous continuerons et agirons
ensemble, contre ceux et celles qui s’en prennent au modèle démocratique,
contre ceux et celles qui veulent gouverner avec et par la peur, contre ceux et
celles qui entendent mettre en œuvre un projet délétère et qui génèrent
eux-mêmes le séparatisme contre lequel ils et elles disent lutter, contre ceux
et celles qui sont à l’origine de la mise à mal du contrat social et de la République.
Organisations signataires : Alternatiba,
Anticor, Anv-Cop21, Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF),
Association de travailleurs maghrébins de France (ATMF), Association des
Marocains en France (AMF), Association nationale d’assistance aux frontières
pour les étrangers (Anafé), ATTAC France, Confédération générale du travail
(CGT), Collectif des associations citoyennes (CAC), Comede, Comité pour le
respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), Droit au logement
(DAL), Emmaüs France, Femmes Egalité, Fondation Copernic, Fédération des
Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), Fédération nationale de
la libre pensée, Fédération syndicale unitaire (FSU), Greenpeace France, Groupe
d’accueil et de solidarités (GAS), Groupe d’information et de soutien des
immigré·es (Gisti), L’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (L’ACORT),
La Cimade, Memorial 98, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples (MRAP), Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes
(RAAR), Syndicat de la magistrature, Union nationale des étudiants de France
(UNEF), Union syndicale Solidaires, Utopia 56, VoxPublic.
Paris, le 11 avril 2023
=====
Politis soutient la Ligue des droits de l’Homme
Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’en est pris directement à la
Ligue des droits de l’Homme, évoquant ses financements publics. La pente
extrémiste du protégé de Nicolas Sarkozy est de plus en plus glissante.
Politis • 6 avril 2023
Auditionné hier au Sénat suite aux violences policières de Sainte-Soline, Gérald Darmanin –
après un week-end passé à attaquer
ses opposants de gauche dans le JDD – s’en est cette fois pris à
un autre adversaire, un peu trop regardant sur sa féroce répression de la contestation actuelle.
S’exprimant sur la Ligue
des droits de l’Homme, le ministre de l’Intérieur a expliqué qu’il s’en
prendrait possiblement au financement public de l’organisme. « Je ne
connais pas la subvention donnée par l’État, mais ça mérite d’être regardé dans
le cadre des actions qui ont pu être menées. »
De tels propos ne peuvent que susciter craintes et indignations. Sur France Info, le président de la LDH, Patrick Baudouin,
a répliqué que « jamais la Ligue des droits de l’Homme n’a été remise
en cause de cette manière ». Et d’ajouter : « C’est inédit
et consternant de la part du ministre d’un pays qui est encore qualifié de
démocratie ».
Politis, journal humaniste, apporte donc son soutien clair et net à
la Ligue des droits de l’Homme, rouage essentiel de la démocratie. La LDH fut
fondée, pour rappel, en 1898 par Ludovic Trarieux, en défense du capitaine
Dreyfus et n’a cessé depuis de défendre les droits humains les plus
fondamentaux.
Fin 2021, Politis publiait, en collaboration avec la Ligue, un
hors-série sur les libertés fondamentales, avec les plumes de François Héran,
Henri Leclerc, Étienne Balibar, Alain Damasio… Ce numéro peut toujours être commandé, en version numérique ou physique, sur notre boutique.
=====
TRIBUNE. « Alerte sur les libertés associatives»
Plusieurs acteurs des secteurs associatifs et syndicaux, dont Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif, Laurent Berger ou encore Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l’Homme, alertent sur la remise en cause de la liberté des associations. Rédaction JDD
Voici leur tribune : « Le 5 avril, le ministre de l’Intérieur, appelé à réagir sur les critiques formulées par la Ligue des droits de l’homme quant à l’action des forces de l’ordre à Sainte-Soline, a indiqué que, dans ce contexte, les subventions accordées par l’État à la LDH devraient être examinées, avant d’enjoindre aux collectivités territoriales de faire de même.
Ces déclarations ont, à juste titre, suscité de
vives réactions. Parce que l’expression du ministre de l’Intérieur ressemble à
un fait du prince usant de son pouvoir pour réduire les oppositions, et parce
qu’elle porte sur une association dont l’histoire est faite, depuis cent
vingt-cinq ans, de combats pour protéger les droits et libertés de tous et
faire vivre les valeurs de la République.
Il est évidemment normal qu’un financeur s’assure
de la bonne utilisation des fonds par les associations qu’il
subventionne ; mais cela sur la base des missions de l’association, pour
lesquelles elle est soutenue ; et non pas conformément à ce que souhaiterait
entendre le gouvernement.
Subventionner une association ne veut pas
dire la contraindre au silence
Subventionner une association ne veut pas dire la
contraindre au silence. La grandeur d’une démocratie est de savoir soutenir la
diversité des approches et des points de vue qui permettent le débat et qui
sont aussi des contre-pouvoirs nécessaires. Il est donc extrêmement grave qu’un
ministre de la République mette ouvertement en question les financements
accordés à une association parce que cette dernière, dans le respect de la loi,
a une parole critique sur l’action de l’État.
Si le ministre de l’Intérieur se permet cette
mise en question si directe, c’est parce que le climat aujourd’hui l’y
autorise. En effet, ces déclarations interviennent dans un contexte de remise
en cause de l’indépendance des associations.
La loi confortant le respect des principes de la
République, dans ses différentes dispositions relatives aux associations, et
notamment le contrat d’engagement républicain, en est la traduction très
concrète. Une boîte de Pandore a été ouverte et met à mal la capacité d’action
et d’interpellation des associations.
Cette fragilisation est dangereuse. Elle a des
impacts sur ceux qui sont engagés pour l’intérêt général et qui se voient
témoigner de la défiance ou opposer des pressions ; des impacts sur la
transformation sociale qui est bien souvent portée par les associations ;
des impacts, enfin et surtout, sur notre vitalité et notre sérénité
démocratiques. La société a plus que jamais besoin de ces espaces de
construction de la parole et de l’action collectives que sont les associations.
Limiter et contraindre ces expressions ne peut que contribuer à exacerber des
tensions déjà vives dans notre société.
La défenseure des droits, dans un communiqué du
14 avril, constate « une intensification des risques d’atteintes
à la liberté d’association » et souligne qu’« une telle
évolution est hautement problématique dans un État démocratique ».
Plus que jamais, il est essentiel de réaffirmer collectivement notre
attachement aux libertés associatives, de rendre publiques toutes les atteintes
qui y seront portées et de nous mobiliser contre ces attaques.
Il est de la responsabilité du gouvernement
d’affirmer haut et fort, en mots et en actes, que les libertés associatives
sont au cœur de notre pacte démocratique. Nous appelons également ceux qui en
savent toute l’importance, et notamment les élus territoriaux qui construisent
au quotidien avec les associations, à se mobiliser pour elles. »
Les signataires
- Claire Thoury, Présidente, Le Mouvement associatif
- Thierry Abalea, Président, Le Mouvement associatif Bretagne
- Yoann Alba, président, Crajep Centre Val de Loire
- Stéphane Alexandre, Co-président, Réseau National des Juniors
Associations
- Fanette Bardin, Arthur Moraglia, Pauline Veron,
Co-président.e.s, Démocratie Ouverte
- Patrick Baudouin, Président, Ligue des droits de l'Homme
- Souâd Belhaddad, Fondatrice, Citoyenneté Possible
- Laurent Berger, Secrétaire général, CFDT
- Patrick Bertrand, Directeur exécutif, Action Santé Mondiale
- François BOUCHON, Président, France Bénévolat
- Lucie Bozonnet, Yann Renault, Arnaud Tiercelin,
coprésident.es , Cnajep
- Olivier Bruyeron, Président, Coordination SUD
- Sylvie Bukhari-De Pontual, Présidente, CCFD-Terre Solidaire
- Rodrigue Carbonnel, Secrétaire général, Fédération des
Aroeven
- Marie-Pierre Cattet, Présidente, Le Mouvement associatif
Bourgogne-Franche Comté
- Philippe Clément, Président, Le Mouvement associatif
Normandie
- Patricia Coler, co-présidente, Mouvement pour l’Economie
Solidaire
- Henry de Cazotte, président, GRET
- Leopold Dauriac, co-président, MES Occitanie
- Charlotte Debray, Déléguée générale, La Fonda
- Michelle Demessine, Présidente, Union nationale des
associations de tourisme
- Jean-Luc Depeyris, directeur général, Sauvegarde du Val
d’Oise
- Thierry Dereux, Président, FNE Hauts de France
- Sophie Descarpentries, Co-présidente, FRENE
- Julie Desmidt, co-présidente, UFISC
- Véronique Devise, Présidente, Secours Catholique – Caritas
France
- Cécile Duflot, Directrice générale, Oxfam France
- Sarah DUROCHER, Présidente, Planning familial
- Gilles Epale, Président, Le Mouvement associatif
Auvergne-Rhône-Alpes
- Christian Eyschen, Secrétaire général, Fédération nationale
de la Libre Pensée
- Jean-Marie Fardeau, Délégué national, VoxPublic
- Beatrice Fonlupt, directrice générale, ADAES 44
- Françoise Fromageau, présidente, Mona Lisa
- Claude Garcera, Président, Union Nationale pour l'Habitat des
Jeunes
- Christophe Gaydier, Président, Animafac
- Iola Gelin, directrice, CEMEA Centre Val de Loire
- Martine Gernez, Présidente, HAMAP
- Dominique Gillot, Présidente, Fédération générale des PEP
- Gérald Godreuil, Délégué général, Fédération Artisans du
Monde
- Bruno Guermonprez, Président, Élevages Sans Frontières
- Dominique Guillien Isenmann, Présidente, Fédération Nationale
solidarité femmes
- Dominique Hays, Président, Réseau Cocagne
- Michel Horn, Président, GRAPE Normandie
- Eric Hugentobler, directeur, Picardie Nature
- Didier Jacquemain, Président, Hexopée
- Véronique Jenn-Treyer, Directrice, Planète Enfants &
Développement
- Michel Jezequel, Président, CRESS Bretagne
- Mohamed Khandriche, Président, Touiza solidarité
- Michel Le Direach, Président, UFCV
- Marion Lelouvier, Présidente, Centre français des Fonds et
Fondations (CFF)
- Jacques Limouzin, Président, Mouvement des Régies
- Marie-Claire Martel, Présidente,COFAC
- Océane Martin, Déléguée générale, Radio Campus France
- Catherine Mechkour-Di Maria, Secrétaire générale, Réseau
national des ressourceries et recycleries
- Hélène Mimar-Rangel, présidente, Radio Occitania
- André Molesin, Responsable régional Occitanie, ESPER
- Alexandre Moreau, Président, Anafé
- Véronique Moreira, Présidente, WECF France
- William Morissé, président, Office de tourisme des Portes
Euréliennes d’Ile de France
- Judith Pavard, Présidente, Fédération nationale des arts de
la rue
- Yvan Pavis, Délégué régional, Fédération des MJC Ile de
France
- Valérie Pélisson-Courlieu, Directrice générale, ESPERER 95
- Philippe Pereira ,Délégué national, Cotravaux
- Guy Plassais, Président, Fédération 95 de la Ligue de
l’Enseignement
- Jean-François Quantin, Coprésident, MRAP
- Marie-Noëlle Reboulet, présidente, Geres
- Marcel Rémon, Directeur, CERAS
- Tristan Rivoallan , Trésorier, Constructions Incongrues
- Christophe Robert, Délégué général, Fondation Abbé Pierre
- Jean-Marc Roirant, Président, Fédération de Paris Ligue de
l’Enseignement
- Christine Rollard, Présidente, OPIE
- Michel Roy, Secrétaire général, Justice et Paix France
- Gilles Rouby, Président, Collectif des Associations
Citoyennes
- Jérôme Saddier ,Président, ESS-France
- Nadjima Saïdou, Présidente, Engagé·e·s & Déterminé·e·s
- Cécile Sajas, Présidente, Crajep Ile de France
- Arnaud Schwartz, Président, France Nature Environnement
- Pierre SEGURA, Président, Fédération nationale des Francas
- Roger Sue, Sociologue
- Antoine SUEUR, Président, Emmaüs France
- Françoise Sturbaut, Présidente, Ligue de l’Enseignement
- Julien Talpin, Chargé de recherche au CNRS, Observatoire des
libertés associatives
- Marielle Thuau, Présidente, Fédération Citoyens & Justice
- Florence Thune, Directrice Générale, Sidaction
- José Tissier, Président, Commerce Equitable France
- Jérémie Torel, co-président, Bénénova
- Mackendie Toutpuissant, Président, FORIM
- Robert Turgis, Président, Le Mouvement associatif
d'Ile-de-France
- Elise Van Beneden, Présidente, Anticor
- Nathalie Vandermersch, Directrice Générale, Ajhiralp
- Didier Vaubaillon, Président, Terre des Hommes France
- Françoise Vernet, Présidente, Terre&Humanisme
- Loreline Vidal, Administratrice référente, Réseau National
des Maisons des Associations
- Jérôme Voiturier, Délégué général, UNIOPSS
- Youlie Yamamoto, Porte-Parole, Attac France