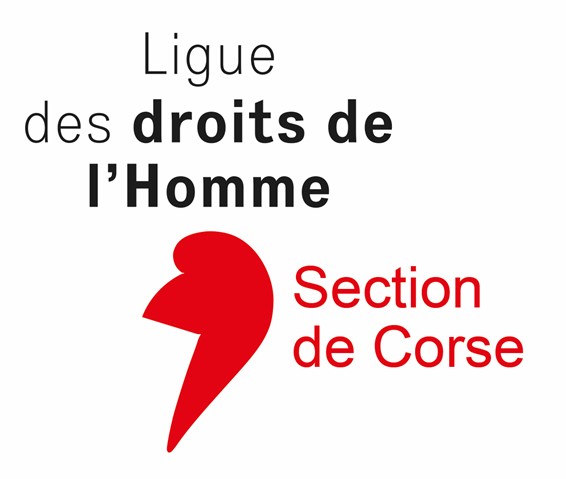"Vouloir un autre avenir":
tribune signée par le bureau de la section mai 2019
"VOULOIR UN AUTRE AVENIR
Rumeurs
malveillantes, tags accusateurs, menaces et exactions, notamment des incendies
criminels, une fois de plus, la Corse semble destinée à revivre des temps
d’inquiétude et de violence.
Dans
le même temps, l’Etat et la Collectivité de Corse se livrent à des polémiques
incessantes sur les compétences des uns et des autres au détriment de
politiques publiques coordonnées répondant aux défis des inégalités sociales et
de l’urgence écologique. Le conflit est permanent et le dialogue entre les deux
parties de plus en plus difficile.
L’Etat
usant de ses pouvoirs ne cesse de mettre en œuvre une politique dirigiste
allant à l’encontre des aspirations des Corses à plus de libertés et plus de
responsabilités. Il ouvre ainsi la porte à de possibles affrontements. Des
bombages « FLNC » font leur réapparition et des caches d’explosifs
sont découvertes la veille d’une manifestation. L’Etat lui-même s’engage dans
cette voie sans issue. Au lendemain d’attentats non revendiqués, il convoque à
nouveau l’antiterrorisme.
Malgré
le climat délétère qui pèse sur la société corse toute entière, nous continuons
à être révoltés contre les injustices. Nous ne perdons pas le sens des
solidarités. Nous n’acceptons pas les atteintes aux libertés et à la dignité.
Nous refusons la banalisation des violences. Nous ne pouvons nous résoudre à
subir. De cette conscience que rien n’est écrit à l’avance peuvent émerger de
nouvelles mobilisations plus fortes et davantage partagées.
Pour
notre part, nous avançons quelques revendications prioritaires :
-
L’organisation de protestations publiques en soutien aux victimes de violence
comme pour cet agriculteur dont l’exploitation a été incendiée ou pour les
agents du Parc naturel régional de Corse menacés. Le refus de l’impunité et
l’exigence de justice afin que la lumière soit faite sur les pratiques
criminelles qui constituent des menaces permanentes pour notre société ;
-
Une nécessaire vigilance face à la justice d’exception dont la Corse a eu à
souffrir les excès. Vingt ans après, constatons simplement que les victimes de
la piste agricole n’ont toujours pas été reconnues à la hauteur de l’arbitraire
qu’elles ont subi. Constatons aussi que l’Etat ne veut toujours pas aujourd’hui
tourner la page de l’assassinat du préfet Erignac alors que cet acte criminel
avait été condamné par des dizaines de milliers de citoyens.
-
Le retour d’un dialogue et le renoncement par l’Etat à son projet de tutelle.
Il faut ouvrir au plus vite de nouveaux espaces politiques qui permettront de
redéfinir un nouveau contrat entre la Corse et la République ; par la
réforme constitutionnelle si nécessaire.
Mais
rien ne se fera sans l’intervention des citoyens et de la société civile,
parties prenantes de cette responsabilité partagée qui, avec les élus et
l’Etat, donnent sens à la démocratie."
Jean-Claude ACQUAVIVA,
Marie-Anne ACQUAVIVA, Pascal ARROYO, Antonin BRETEL, Frédérique CAMPANA,
Jean-François CASALTA, Jean-Sébastien de CASALTA, Christine MATTEI-PACCOU,
Ibtissam MAYSSOUR-STALLA, Gérard MORTREUIL, André PACCOU, Patrizia POLI, Elsa
RENAUT, Dumé RENUCCI, Sampiero SANGUINETTI
________________________________________
"Construire des temps d’avenir en Corse" -
Tribune d'André PACCOU publiée dans Hommes & Libertés de mars
2018


Pour un projet de transformation démocratique et sociale en Corse.
En obtenant la majorité absolue à l’élection territoriale de décembre
dernier - 56,5% des suffrages exprimés - les nationalistes confirment leurs
résultats à l‘élection municipale de mars 2014, avec la conquête de plusieurs
dizaines de municipalités dont la ville de Bastia, ainsi que leur première
victoire à la territoriale de 2015 et leurs résultats à la législative de juin
2017 avec l’élection de trois députés sur quatre.
2014-2017 : un tournant historique
Certains relativisent cette nouvelle
progression en arguant d’un taux d’abstention élevé au second tour de
l’élection territoriale, 47,4%. Mais contestent-ils la légitimité de la
majorité présidentielle à l’Assemblée nationale, issue d’un scrutin marqué au
second tour par une abstention nationale supérieure de dix points à celle
observée au second tour de l’élection corse.
La période 2014-2017 constitue un tournant
dans l’histoire contemporaine de la Corse. Elle assoit l’implantation
électorale des nationalistes et confirme le déclin des clans qui structuraient
la scène politique insulaire depuis plusieurs décennies. A gauche, le clan
Zuccarelli battu à Bastia lors de la municipale de 2014 par la liste de Gilles
Simeoni et le clan Giacobbi désormais absent de l’Assemblée nationale et
de l’Assemblée de Corse. A droite, le clan de Rocca de Serra défait à
l’élection cantonale de 2011 dans son fief historique de Porto-Vecchio par le
nationaliste Jean-Christophe Angelini. A nouveau battu lors de la législative
de 2017 par un nationaliste, Paul-André Colombani.
Enfin félicitons-nous de l’échec de
l’extrême-droite lors de cette dernière territoriale. Quelle que soit sa
version, jacobine avec le FN, ou se revendiquant du peuple corse et
particulièrement impliquée dans les récentes agitations racistes et xénophobes,
l’extrême- droite ne sera plus représentée à l’Assemblée de Corse.
Le cercle vertueux de la démocratie
En annonçant la fin des attentats en juin
2014, le FLNC a contribué à cette évolution. Mais il ne faudrait pas pour
autant sous-estimer l’engagement nationaliste dans le combat démocratique bien
avant cette annonce. Durant ces cinquante dernières années, les
nationalistes ont participé régulièrement à des élections. Ils se sont
fortement investis dans le mouvement civique et social.
Au sortir des décolonisations, le
nationalisme inspire les jeunes générations. Il se déploie dans tous les
domaines. Sa dénonciation du clanisme et de ses perversions rappelle que le
droit de vote et d’être élu demeure une conquête des citoyens. Son implication
dans le riacquistu (1) ou pour la réouverture d’une
université en Corse porte l’espoir d’une identité ouverte, fondée sur un
nouveau droit linguistique, le développement culturel et le droit à
l’éducation. Sa contribution aux luttes sociales, avec le syndicat des
travailleurs corses devenu le premier syndicat de salariés dans l’île,
accompagne l’émergence d’un salariat urbain… Au fil du temps, le nationalisme
étend progressivement son hégémonie politique et culturelle sur la société
corse. Ne pas prendre en compte cette influence sur le développement
démocratique à l’œuvre depuis les années 1970, c’est ne pas voir un des
fondements de la question corse : l’affirmation progressive d’une nouvelle
société politique.
La fabrication d’un nouvel imaginaire
politique
En effet depuis la fin des années 60, un
renouveau démocratique travaille la société corse. De même, une succession
d’évènements de nature diverse s’entremêlent ; d’une part des attentats
mais aussi des assassinats, d’autre part des manifestations de rue, des actions
devant la justice, des grèves, des débats publics... Hors de l’île, la
représentation d’une société chaotique, désordonnée, violente domine,
conséquence selon un rapport parlementaire établi au lendemain de l’assassinat
du préfet Erignac, de « l’attitude ambigüe que les Corses observent à
l’égard du droit et, plus généralement, à l’égard des règles d’organisation
d’une société démocratique moderne. » (2) On sait ce qu’il
adviendra de cette caricature et de la restauration de l’état de droit préconisée
dans ce rapport puis confiée à un préfet, Bernard Bonnet, visant par tous les
moyens à déstabiliser la société corse pour mieux la soumettre au droit
exclusif de l’Etat.
Durant cette période, un demi-siècle, la
société politique corse qui émerge n’est pas prisonnière des agitations. Elle
s’émancipe. Elle se réapproprie une histoire plus lointaine. Elle met en scène
les révolutions démocratiques corses du dix-huitième siècle, la Constitution de
Pascal Paoli, la conquête française… La citation de Jean-Jacques Rousseau
« J’ai le sentiment qu’un jour, cette petite île étonnera l’Europe »
devient une référence (3). Dans les consciences, un nouveau
temps historique se déploie. Une continuité s’établit entre le temps présent,
celui d’un bouillonnement démocratique, et une histoire plus lointaine. La
certitude de partager un destin commun dans la longue durée devient une
conviction partagée au-delà du nationalisme : « La Corse fabrique des
Corses ».
Pendant un temps, la gauche comprend ces
évolutions. Le 12 avril 1989, devant l’Assemblée nationale, Michel Rocard,
premier ministre, déclare : « Votre question me permet d'exprimer
aujourd'hui mon sentiment profond… sur ce que l'on a appelé ici ou là le
problème corse… Le mal… vient de loin. Il est donc nécessaire de rappeler les
raisons de la situation actuelle. La France a acheté les droits de suzeraineté
sur la Corse à la République de Gênes, mais il a fallu une guerre pour les
traduire dans les faits. ». Et d’ajouter : « Pendant que nous
construisions, sous la Ill e République, notre démocratie locale, nos conseils
généraux, nos libertés communales, la Corse était sous gouvernement militaire.
» (4). Le 2 mai 1990, l’article 1er du projet
de loi du ministre de l’intérieur Pierre Joxe reconnaît « le peuple corse,
composante du peuple français » (5). Le Conseil
constitutionnel (6) censurera cette formule symbolique.
Mais peu importe cette décision face à
« un peuple...qui malgré les incertitudes et les doutes, s’invente dans de
nouvelles conditions de lutte auxquelles un art nécessairement politique doit
contribuer » (7). Trente années ont passé. Le peuple corse
demeure un projet de société.
Il faut savoir raison garder
Aujourd’hui, la situation corse
lorsqu’elle est perçue comme un syndrome catalan désoriente bien des esprits.
Les amalgames l’emportent alors sur la capacité à distinguer des situations
différentes. La capacité à agir sur le réel est aussi atteinte. Pour la Corse,
l’Etat va-t-il se laisser gagner par cette mauvaise fièvre ?
Certains tenants de l’ordre établi tirent
en arrière en s’appuyant sur quelques relais politiques locaux afin de diviser
pour mieux régner. A la veille des élections territoriales, ils procèdent au
transfert autoritaire d’une compétence sur le logement social à la Communauté
de communes du pays ajaccien au détriment de la Collectivité de Corse. Le
clanisme est sur le déclin mais les candidatures à un néo-clanisme ne manquent
pas. Les mêmes veulent maintenir une tutelle de l’Etat sur la Corse : le
décret instaurant une Chambre des territoires de Corse dans le cadre de la
création de la Collectivité unique ne prend en compte aucun des avis émis par
l’Assemblée de Corse même lorsqu’il s’agit simplement d’améliorer la parité
hommes femmes au sein de cette institution. Ce sont toujours les mêmes qui
parient sur un échec de la majorité nationaliste dans la mise en œuvre de la
nouvelle collectivité unique.
Dans le même temps, l’Etat annonce une
possible inscription de la Corse dans la Constitution et un droit de
différenciation dans l’application de la loi pour toutes les régions, semblant
hésiter entre une reconnaissance de la singularité corse au plus haut niveau de
la loi et une banalisation de la question corse, une région comme les autres.
Il rappelle systématiquement des lignes rouges à ne pas dépasser.
« Gouverner, c’est prévoir »
dit-on. Que ceux qui ont en responsabilité la conduite de l’Etat fassent leur
cette devise. Ou bien ils considèrent la Corse comme une ligne Maginot et les
Corses comme des ennemis intérieurs. Ou bien ils entendent les aspirations des
Corses à plus de droit, plus de responsabilité et davantage de maîtrise de leur
destin.
Construire des temps d’avenir
L’Etat peut changer rapidement de
trajectoire. En contribuant à l’apaisement par la simple application de la loi
en matière de liberté conditionnelle, de fin de peine de sûreté et de
transfèrement en Corse pour tous les prisonniers politiques. En décidant
d’engager un dialogue sans tabou avec l’Assemblée de Corse. Dès lors, chaque
partie devra avoir en conscience sa part de responsabilité dans le devenir de
ce dialogue. Répondre à la fois à un impératif démocratique - à terme,
renoncer à la clandestinité et en finir avec la répression politique et
l’antiterrorisme. Répondre également à un impératif de
solidarité - rétablir au plus vite une situation sociale
normale, l’accès aux droits pour des dizaines de milliers de personnes victimes
de la précarité voire de la grande pauvreté pour un Corse sur cinq.
Nous vivons dans un monde mondialisé et
interdépendant. Et dans ce monde-là, l’émergence de nouveaux espaces politiques
infra et supra-étatiques ainsi que la constitution de firmes transnationales
réduisent la vision d’un Etat seul souverain dans son palais à un mirage.
Doit-on pour autant constater les migrations dangereuses pour les victimes de
la guerre et de la misère, le saccage de notre environnement, le recul de la
diversité culturelle et linguistique comme autant de fatalités ? Ce serait
ignorer les résistances et les transformations à l’œuvre. Ce serait abdiquer
toute citoyenneté et démissionner de nos responsabilités envers les générations
futures. Le débat sur la Corse relève de cette dimension.
La
Corse est à un tournant historique, écrivons-nous plus haut. La question de la
société politique corse, à la fois la citoyenneté en Corse et celle son
déploiement institutionnel, doit être abordée clairement. Dans notre monde, poser la question d’une
responsabilité partagée avec l’Etat, c’est vouloir répondre à la nécessité de
nouvelles régulations démocratiques au niveau local. En ce sens, un pouvoir
législatif peut être attribué à la Collectivité unique en relation par exemple,
avec les compétences d’aménagement et de développement de l’institution.
Si ce pouvoir est attribué à l’Assemblée de Corse, alors il faudra en tirer
toutes les conséquences en terme de citoyenneté, et donner le droit de vote et
d’être élu à celles et ceux qui sont installé-e-s durablement dans l’île, quel
que soit leur lieu de naissance ou leur lignage.
Mais l’impératif démocratique est
indissociable de l’impératif de solidarité. Ici comme ailleurs, l’abstention
s’explique principalement par le désengagement de citoyens victimes de la
raison économique. La Collectivité de Corse peut être mise au service d’un
projet de transformation démocratique et sociale. La citoyenneté sociale n’aura
d’existence que si elle se traduit par une participation effective de tous les
citoyens à la définition, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques
mises en œuvre par cette Collectivité. Dans le prolongement du développement
démocratique à l’œuvre depuis cinquante ans, il s’agit d’organiser l’agora du
XXIe siècle, « l’agir ensemble » qui permettra de
réinventer le rôle des institutions de la République afin de mieux lutter
contre les inégalités et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique.
« Lorsqu’on veut changer les
choses et innover dans une république, c’est moins les choses que le temps que
l’on considère » Faisons nôtre cette réflexion de La Bruyère (8).
Considérons que des temps nouveaux, des temps d’avenir sont plus que jamais à
l’ordre du jour. Mais dans l’immédiat, il revient au gouvernement de
répondre à la main qui lui est tendue.
(1) En
français, la « réacquisition ». Important mouvement social de
réappropriation de la culture et de la langue corse (création de chants et de
groupes polyphoniques, de pièces et de troupes de théâtre, multiplication de
publications, universités d’été pour la réouverture de l’université de Corse…)
(2) « Corse,
l’indispensable sursaut » (rapport fait sur l’utilisation des fonds
publics et la gestion des services publics en Corse adopté par l’Assemblée
nationale le 2/9/2018)
(3) « Le contrat
social » de Jean-Jacques Rousseau
(4) Journal officiel de la
République française – débats parlementaires – Assemblée nationale (Année 1989.
N° 7A.N. (C.R.) – Jeudi 13 avril 1989)
(5) Projet de loi portant
statut de la collectivité territoriale de Corse.
(7) « L'image-temps » de
Gilles Deleuze (Extrait repris dans l'introduction du « Manifeste pour les
produits de haute nécessité » d’Ernest Breleur, Patrick Chamoiseau, Serge Domi,
Gérard Delver, Edouard Glissant, Guillaume Pigeard de Guibert, Olivier Portecop,
Olivier Pulvar, Jean Caide William)
(8) « Les
caractères » de Jean de La Bruyère
___________________________
POUR UNE RESPONSABILITE PARTAGEE
Tribune signée
par les membres du bureau de la section, publiée dans le Settimana du 2 mars 2018
Ces dernières semaines, ce qui devait être les
prémices d’un dialogue s’est transformé en tensions. D’autres conflits
pourraient survenir. Devant ces incertitudes, rappelons avec force qu’une
majorité de Corses, au travers de plusieurs élections, ont fait le choix d’une
autre relation entre la Corse et l’Etat, celle d’une responsabilité partagée.
Nous pouvons mettre fin à une tutelle synonyme d’humiliation autrement que dans
un face-à-face, en déployant un art nécessairement politique par lequel le
peuple corse continue à s’inventer.
Dans l’immédiat, la revendication du rapprochement
des prisonniers politiques y compris les détenus particulièrement signalés,
demeure une condition nécessaire à l’apaisement. De même que l’inscription de
la Corse dans la Constitution. Un échéancier a enfin été précisé par le
Président de la République. Il revient au gouvernement et aux élus de trouver
les termes qui permettront non pas de banaliser la Corse parmi les régions
françaises, mais de garantir sa singularité. En ce sens, un pouvoir législatif
peut être attribué à la collectivité de Corse.
Le respect de la singularité corse passe
nécessairement par la prise en compte de la question linguistique. Affirmer
qu’on parle français en Corse comme partout ailleurs sur le territoire national
peut paraître du bon sens. C’est en fait relativiser l’existence d’un
bilinguisme historique au détriment de la langue corse aujourd’hui en danger.
En s’exprimant de la sorte, a contrario du bilinguisme qu’il entend promouvoir,
l’Etat semble méprisant. Il est temps d’ouvrir un véritable dialogue sur la
place de la langue corse en Corse et sur la reconstruction d’une société bilingue
associant corsophones et non corsophones.
La mise en œuvre de la collectivité de Corse
constitue un enjeu de première importance. La majorité territoriale
a la responsabilité première de cette installation. Mais l’Etat ne peut se
défausser. Le bon fonctionnement de l’Etat en Corse est tributaire du bon
fonctionnement de la collectivité de Corse, et inversement.
La nouvelle organisation territoriale de la Corse
interroge sur le risque d’une centralisation du pouvoir politique. Devant cette
possible dérive, le conseil économique, social, environnemental, le CESE, et la
chambre des territoires doivent jouer leur rôle de contre-pouvoirs. A l’instar
du CESE, la chambre des territoires pourrait s’autosaisir de dossiers relevant
de son champ d’intervention et contribuer ainsi à la délibération au-delà d’un
simple avis.
Mais surtout, la mise en œuvre de la collectivité de
Corse, au travers de la définition de ses politiques publiques, est l’affaire
de tous les citoyens. Une démocratie délibérative reste à inventer. Avec la
perspective d’un transfert d’une compétence législative à la collectivité de
Corse, l’association des citoyens à la délibération sonne comme une évidence
démocratique.
Face aux attaques qui se multiplient contre le
PADDUC, il y aussi urgence à mettre en œuvre cette nouvelle démocratie. Le
PADDUC n’est pas un « super PLU ». Il est un projet de société qui
s’est construit à l’origine sur une forte mobilisation de la société civile
contre la désanctuarisation de la Corse. Alors que se développent les
inégalités sociales et territoriales, certains rêvent de davantage
d’enrichissement personnel et d’un modèle entrepreneurial hégémonique, celui de
la compétition et de l’efficacité dans la conquête des marchés, au détriment
des solidarités et des protections pour tous.
Par leur vote, les citoyen-ne-s ont fait le choix de
plus de droits et de libertés pour davantage de responsabilité. Mais il faut
s’entendre sur le sens des mots. Plus de droits et de libertés ne signifient
pas plus de pouvoir donné aux plus forts mais davantage de responsabilité
collective.
Le droit au logement qui n’est pas le droit de
propriété constitue de toute évidence une priorité. Il pourrait être une
compétence de la collectivité de Corse, en cohérence avec ses compétences en
matière d’aménagement et de développement économique. Le droit à la santé,
l’accès aux soins pour tous, à juste titre régulièrement revendiqués par les
syndicats et des collectifs de citoyens et d’élus sont une autre priorité.
L’artificialisation accélérée des sols constitue un
défi majeur pour l’environnement, pour la préservation des terres agricoles et
pour un équilibre entre les territoires. Il faut ici agir au plus vite. Plus
généralement, il nous faut nous mobiliser contre les inégalités et pour un
développement durable. Le principe d’une responsabilité sociale et
environnementale doit être au fondement de l’action publique en tous domaines.
Nous vivons dans un monde mondialisé et
interdépendant. Et dans ce monde-là, l’émergence de nouveaux espaces politiques
infra et supra-étatiques ainsi que la constitution de firmes transnationales
réduisent la vision d’un Etat seul souverain dans son palais à un mirage.
Doit-on pour autant constater les migrations dangereuses pour les victimes de
la guerre et de la misère, le saccage de notre environnement, le recul de la
diversité culturelle et linguistique comme autant de fatalités ? Ce serait
ignorer les résistances et les transformations à l’œuvre. Ce serait abdiquer
toute citoyenneté et démissionner de nos responsabilités envers les générations
futures. Le débat sur la Corse relève de cette dimension.
Le bureau de la LDH Corsica : Jean-Claude
ACQUAVIVA, Marie-Anne ACQUAVIVA, Antonin BRETEL, Frédérique CAMPANA,
Jean-François CASALTA, Jean-Sébastien de CASALTA, Francine DEMICHEL, Christine
MATTEI-PACCOU, Ibtissam MAYSSOUR-STALLA, Gérard MORTREUIL, André PACCOU, Elsa
RENAUT, Dumé RENUCCI, Sampiero SANGUINETTI
"Construire des temps d’avenir en
Corse"
Tribune d'André PACCOU publiée
dans Hommes &
Libertés n°181 de mars 2018
Pour un projet de
transformation démocratique et sociale en Corse.
En obtenant la majorité absolue à l’élection
territoriale de décembre dernier - 56,5% des suffrages exprimés - les
nationalistes confirment leurs résultats à l‘élection municipale de mars 2014,
avec la conquête de plusieurs dizaines de municipalités dont la ville de
Bastia, ainsi que leur première victoire à la territoriale de 2015 et leurs
résultats à la législative de juin 2017 avec l’élection de trois députés sur
quatre.
2014-2017 :
un tournant historique
Certains
relativisent cette nouvelle progression en arguant d’un taux d’abstention élevé
au second tour de l’élection territoriale, 47,4%. Mais contestent-ils la
légitimité de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale, issue d’un
scrutin marqué au second tour par une abstention nationale supérieure de dix
points à celle observée au second tour de l’élection corse.
La période
2014-2017 constitue un tournant dans l’histoire contemporaine de la Corse. Elle
assoit l’implantation électorale des nationalistes et confirme le déclin des
clans qui structuraient la scène politique insulaire depuis plusieurs
décennies. A gauche, le clan Zuccarelli battu à Bastia lors de la municipale de
2014 par la liste de Gilles Simeoni et le clan Giacobbi désormais absent
de l’Assemblée nationale et de l’Assemblée de Corse. A droite, le clan de Rocca
de Serra défait à l’élection cantonale de 2011 dans son fief historique de
Porto-Vecchio par le nationaliste Jean-Christophe Angelini. A nouveau battu
lors de la législative de 2017 par un nationaliste, Paul-André Colombani.
Enfin
félicitons-nous de l’échec de l’extrême-droite lors de cette dernière
territoriale. Quelle que soit sa version, jacobine avec le FN, ou se
revendiquant du peuple corse et particulièrement impliquée dans les récentes
agitations racistes et xénophobes, l’extrême- droite ne sera plus représentée à
l’Assemblée de Corse.
Le cercle
vertueux de la démocratie
En annonçant la
fin des attentats en juin 2014, le FLNC a contribué à cette évolution. Mais il
ne faudrait pas pour autant sous-estimer l’engagement nationaliste dans le
combat démocratique bien avant cette annonce. Durant ces cinquante
dernières années, les nationalistes ont participé régulièrement à des
élections. Ils se sont fortement investis dans le mouvement civique et social.
Au sortir des
décolonisations, le nationalisme inspire les jeunes générations. Il se déploie
dans tous les domaines. Sa dénonciation du clanisme et de ses perversions
rappelle que le droit de vote et d’être élu demeure une conquête des citoyens.
Son implication dans le riacquistu (1) ou pour la
réouverture d’une université en Corse porte l’espoir d’une identité ouverte,
fondée sur un nouveau droit linguistique, le développement culturel et le droit
à l’éducation. Sa contribution aux luttes sociales, avec le syndicat des
travailleurs corses devenu le premier syndicat de salariés dans l’île,
accompagne l’émergence d’un salariat urbain… Au fil du temps, le nationalisme
étend progressivement son hégémonie politique et culturelle sur la société
corse. Ne pas prendre en compte cette influence sur le développement
démocratique à l’œuvre depuis les années 1970, c’est ne pas voir un des
fondements de la question corse : l’affirmation progressive d’une nouvelle
société politique.
La fabrication
d’un nouvel imaginaire politique
En effet depuis
la fin des années 60, un renouveau démocratique travaille la société corse. De
même, une succession d’évènements de nature diverse s’entremêlent ; d’une
part des attentats mais aussi des assassinats, d’autre part des manifestations
de rue, des actions devant la justice, des grèves, des débats publics... Hors
de l’île, la représentation d’une société chaotique, désordonnée, violente
domine, conséquence selon un rapport parlementaire établi au lendemain de
l’assassinat du préfet Erignac, de « l’attitude ambigüe que les Corses
observent à l’égard du droit et, plus généralement, à l’égard des règles
d’organisation d’une société démocratique moderne. » (2) On
sait ce qu’il adviendra de cette caricature et de la restauration de l’état de
droit préconisée dans ce rapport puis confiée à un préfet, Bernard Bonnet,
visant par tous les moyens à déstabiliser la société corse pour mieux la
soumettre au droit exclusif de l’Etat.
Durant cette
période, un demi-siècle, la société politique corse qui émerge n’est pas
prisonnière des agitations. Elle s’émancipe. Elle se réapproprie une histoire
plus lointaine. Elle met en scène les révolutions démocratiques corses du
dix-huitième siècle, la Constitution de Pascal Paoli, la conquête française… La
citation de Jean-Jacques Rousseau « J’ai le sentiment qu’un jour, cette
petite île étonnera l’Europe » devient une référence (3).
Dans les consciences, un nouveau temps historique se déploie. Une continuité
s’établit entre le temps présent, celui d’un bouillonnement démocratique, et
une histoire plus lointaine. La certitude de partager un destin commun dans la
longue durée devient une conviction partagée au-delà du nationalisme :
« La Corse fabrique des Corses ».
Pendant un
temps, la gauche comprend ces évolutions. Le 12 avril 1989, devant l’Assemblée
nationale, Michel Rocard, premier ministre, déclare : « Votre question me
permet d'exprimer aujourd'hui mon sentiment profond… sur ce que l'on a appelé
ici ou là le problème corse… Le mal… vient de loin. Il est donc nécessaire de
rappeler les raisons de la situation actuelle. La France a acheté les droits de
suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes, mais il a fallu une guerre
pour les traduire dans les faits. ». Et d’ajouter : « Pendant
que nous construisions, sous la Ill e République, notre démocratie locale, nos
conseils généraux, nos libertés communales, la Corse était sous gouvernement
militaire. » (4). Le 2 mai 1990, l’article 1er du
projet de loi du ministre de l’intérieur Pierre Joxe reconnaît « le peuple
corse, composante du peuple français » (5). Le Conseil
constitutionnel (6) censurera cette formule symbolique.
Mais peu importe
cette décision face à « un peuple...qui malgré les incertitudes et les
doutes, s’invente dans de nouvelles conditions de lutte auxquelles un art
nécessairement politique doit contribuer » (7). Trente
années ont passé. Le peuple corse demeure un projet de société.
Il faut savoir
raison garder
Aujourd’hui, la
situation corse lorsqu’elle est perçue comme un syndrome catalan désoriente
bien des esprits. Les amalgames l’emportent alors sur la capacité à distinguer
des situations différentes. La capacité à agir sur le réel est aussi atteinte.
Pour la Corse, l’Etat va-t-il se laisser gagner par cette mauvaise
fièvre ?
Certains tenants
de l’ordre établi tirent en arrière en s’appuyant sur quelques relais
politiques locaux afin de diviser pour mieux régner. A la veille des élections
territoriales, ils procèdent au transfert autoritaire d’une compétence sur le
logement social à la Communauté de communes du pays ajaccien au détriment de la
Collectivité de Corse. Le clanisme est sur le déclin mais les candidatures à un
néo-clanisme ne manquent pas. Les mêmes veulent maintenir une tutelle de l’Etat
sur la Corse : le décret instaurant une Chambre des territoires de Corse
dans le cadre de la création de la Collectivité unique ne prend en compte aucun
des avis émis par l’Assemblée de Corse même lorsqu’il s’agit simplement
d’améliorer la parité hommes femmes au sein de cette institution. Ce sont toujours
les mêmes qui parient sur un échec de la majorité nationaliste dans la mise en
œuvre de la nouvelle collectivité unique.
Dans le même
temps, l’Etat annonce une possible inscription de la Corse dans la Constitution
et un droit de différenciation dans l’application de la loi pour toutes les
régions, semblant hésiter entre une reconnaissance de la singularité corse au
plus haut niveau de la loi et une banalisation de la question corse, une région
comme les autres. Il rappelle systématiquement des lignes rouges à ne pas
dépasser.
« Gouverner,
c’est prévoir » dit-on. Que ceux qui ont en responsabilité la conduite de
l’Etat fassent leur cette devise. Ou bien ils considèrent la Corse comme une
ligne Maginot et les Corses comme des ennemis intérieurs. Ou bien ils entendent
les aspirations des Corses à plus de droit, plus de responsabilité et davantage
de maîtrise de leur destin.
Construire des
temps d’avenir
L’Etat peut
changer rapidement de trajectoire. En contribuant à l’apaisement par la simple
application de la loi en matière de liberté conditionnelle, de fin de peine de
sûreté et de transfèrement en Corse pour tous les prisonniers politiques. En
décidant d’engager un dialogue sans tabou avec l’Assemblée de Corse. Dès lors,
chaque partie devra avoir en conscience sa part de responsabilité dans le
devenir de ce dialogue. Répondre à la fois à un impératif démocratique - à
terme, renoncer à la clandestinité et en finir avec la répression politique et
l’antiterrorisme. Répondre également à un impératif de
solidarité - rétablir au plus vite une situation sociale
normale, l’accès aux droits pour des dizaines de milliers de personnes victimes
de la précarité voire de la grande pauvreté pour un Corse sur cinq.
Nous vivons dans
un monde mondialisé et interdépendant. Et dans ce monde-là, l’émergence de
nouveaux espaces politiques infra et supra-étatiques ainsi que la constitution
de firmes transnationales réduisent la vision d’un Etat seul souverain dans son
palais à un mirage. Doit-on pour autant constater les migrations dangereuses
pour les victimes de la guerre et de la misère, le saccage de notre
environnement, le recul de la diversité culturelle et linguistique comme autant
de fatalités ? Ce serait ignorer les résistances et les transformations à
l’œuvre. Ce serait abdiquer toute citoyenneté et démissionner de nos
responsabilités envers les générations futures. Le débat sur la Corse relève de
cette dimension.
La Corse est à un tournant historique, écrivons-nous
plus haut. La question de la société politique corse, à la fois la citoyenneté
en Corse et celle son déploiement institutionnel, doit être abordée
clairement. Dans notre monde, poser la question d’une
responsabilité partagée avec l’Etat, c’est vouloir répondre à la nécessité de
nouvelles régulations démocratiques au niveau local. En ce sens, un pouvoir
législatif peut être attribué à la Collectivité unique en relation par exemple,
avec les compétences d’aménagement et de développement de l’institution.
Si ce pouvoir est attribué à l’Assemblée de
Corse, alors il faudra en tirer toutes les conséquences en termes de
citoyenneté, et donner le droit de vote et d’être élu à celles et ceux qui sont
installé-e-s durablement dans l’île, quel que soit leur lieu de naissance ou
leur lignage.
Mais l’impératif
démocratique est indissociable de l’impératif de solidarité. Ici comme
ailleurs, l’abstention s’explique principalement par le désengagement de
citoyens victimes de la raison économique. La Collectivité de Corse peut être
mise au service d’un projet de transformation démocratique et sociale. La
citoyenneté sociale n’aura d’existence que si elle se traduit par une
participation effective de tous les citoyens à la définition, au suivi et à
l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par cette Collectivité.
Dans le prolongement du développement démocratique à l’œuvre depuis cinquante
ans, il s’agit d’organiser l’agora du XXIe siècle,
« l’agir ensemble » qui permettra de réinventer le rôle des
institutions de la République afin de mieux lutter contre les inégalités et de
promouvoir la diversité culturelle et linguistique.
« Lorsqu’on
veut changer les choses et innover dans une république, c’est moins les choses
que le temps que l’on considère » Faisons nôtre cette réflexion de La
Bruyère (8). Considérons que des temps nouveaux, des temps
d’avenir sont plus que jamais à l’ordre du jour. Mais dans l’immédiat, il
revient au gouvernement de répondre à la main qui lui est tendue.
(1) En français, la « réacquisition ».
Important mouvement social de réappropriation de la culture et de la langue
corse (création de chants et de groupes polyphoniques, de pièces et de troupes
de théâtre, multiplication de publications, universités d’été pour la
réouverture de l’université de Corse…)
(2) « Corse, l’indispensable sursaut » (rapport fait sur
l’utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse
adopté par l’Assemblée nationale le 2/9/2018)
(3) « Le contrat social » de Jean-Jacques Rousseau
(4) Journal officiel de la République française – débats parlementaires –
Assemblée nationale (Année 1989. N° 7A.N. (C.R.) – Jeudi 13 avril 1989)
(5) Projet de loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
(7) « L'image-temps » de Gilles Deleuze (Extrait repris dans l'introduction
du « Manifeste pour les produits de haute nécessité » d’Ernest Breleur, Patrick
Chamoiseau, Serge Domi, Gérard Delver, Edouard Glissant, Guillaume Pigeard de
Guibert, Olivier Portecop, Olivier Pulvar, Jean Caide William)
(8) « Les caractères » de Jean de La
Bruyère
"Pour un nouveau droit linguistique en Corse
" Contribution d'André PACCOU, publiée dans la revue Hommes & Libertés
n°179 d'octobre 2017
Le conflit entre la langue française et la langue corse, qui s’est
particulièrement affirmé depuis le « riacquistu » (1) des années
1970, demeure un enjeu politique majeur de la « question corse ».
Genèse.
De part et d’autre, le lien
systématiquement revendiqué entre langue et identité tend à figer les
positions. Soit il fait craindre une dérive communautariste, voire une atteinte
à la souveraineté nationale. Soit le lien est associé à un délitement social
irrémédiable, à la disparition à terme du peuple corse. Comment dépasser cet
antagonisme et progresser vers un projet de société où le français et le corse
se développeraient sans vouloir s’exclure ? L’Unesco classe le corse parmi
les langues en danger dans le monde (2). Ce constat est établi à partir d’une
grille de neuf critères de vitalité d’une langue. Il s’inscrit dans une
mobilisation de l’institution internationale, dont les objectifs sont la prise
de conscience des menaces qui pèsent sur les langues et la sauvegarde de la
diversité linguistique mondiale.
En France, l’Unesco recense vingt-six
langues non officielles, dont vingt-trois « en danger » (elles ne
sont plus enseignées aux enfants comme langues maternelles à la maison) ou
« sérieusement en danger » (elles sont seulement parlées par les grands-parents
et les générations les plus âgées.). Cette situation inquiétante interroge
notre modèle républicain et sa capacité à garantir la diversité linguistique.
Elle fait écho au refus obstiné que la France oppose à la ratification de la
Charte européenne des langues régionales et minoritaires.
Le Conseil constitutionnel motive ce refus
par les atteintes que la Charte porterait aux principes constitutionnels
d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français (3).
L’attribution de « droits spécifiques à des"groupes" de
locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans
lesquels ces langues sont parlées » est particulièrement ciblée.
Le français au service d’un Etat unitaire
Comment, à la lecture de cette décision,
ne pas entendre comme un bruit de fond les propos de l’abbé Grégoire dans
son « Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et
d’universaliser la langue française » (juin 1794) ? « On
peut assurer sans exagération qu’au moins six millions de Français […] ignorent
la langue nationale. […] Avec trente patois différents, nous
sommes encore, pour le langage, à la tour de Babel, tandis que, pour la
liberté, nous formons l’avant-garde des nations. […] On peut
uniformiser le langage d’une grande nation, de manière que tous les citoyens
qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette
entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du
peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale
et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République une et
indivisible, l’usage unique et invariable de la liberté. »
Le linguiste Alain Rey rappelle que « le
mythe de Babel, connu à l'intérieur des croyances judéo-chrétiennes, était
fondé sur l'idée que les réalités observables de la parole humaine, en matière
de communication, étaient le résultat de l'orgueil humain, destructeur de la
parole unique de Dieu, le Verbum latin. L'existence de nombreuses langues différentes
bloquant l'harmonie universelle de l'humanité reflétait alors l'imperfection
humaine face à la perfection unitaire du Dieu monothéiste ».
Le monolinguisme, passion qui vient de
loin
Le rapport de l’abbé Grégoire, document de
référence, s’inscrit dans la continuité du projet politique de la monarchie
absolue dont l’acte fondateur fut l’ordonnance de Villers-Cotterêts. L’objectif
de l’ordonnance signée en 1539 par François 1er est de
substituer l’ordre royal à l’ordre ecclésiastique et aux ordres coutumiers, et
le français au latin et aux langues locales. Le français, plus
précisément la langue d’oïl, devient langue du royaume.
Pour augmenter l’emprise du pouvoir
politique sur la langue, Louis XIV crée l'Académie française en 1635.
L’Académie a pour mission d’unifier le français, notamment afin d’en faire
une norme pour les rédacteurs de lois et de documents administratifs. L’écrit
est au cœur de ce processus de normalisation et de centralisation. « La
perfection du pouvoir passe par le contrôle de la coutume… contrôle que l’écrit
permet enfin aux lettrés de réaliser. Simultanément, la classe juridique
s’assure le monopole des sources du droit puisque aussi bien la masse du peuple
est illettrée. » (4)
De nos jours, le rôle de gardienne du
temple de l’Académie ne se dément pas. En 2008, celle-ci s’oppose à la mention
des langues régionales dans la Constitution, adoptée par les députés (5).
Jaurès plutôt que l’abbé Grégoire
Jean Jaurès ne craignait pas les langues
régionales, fussent-elles parlées par des groupes de locuteurs à l’intérieur de
territoires. Son article « Méthode comparée » de 1911 (6) en
atteste : « Il y a quelques semaines, j’ai eu l’occasion d’admirer
en pays basque comment un antique langage … avait disparu. Dans les rues de
Saint-Jean-de-Luz on n’entendait guère parler que le basque, par la bourgeoisie
comme par le peuple. […] Quand j’ai voulu me rendre
compte de son mécanisme … aucune indication. Pas une grammaire basque, pas un
lexique basque dans Saint-Jean-de-Luz où il y a pourtant de bonnes librairies.
Quand j’interrogeais les enfants basques, […] ils avaient le
plus grand plaisir à me nommer dans leur langue le ciel, la mer, le sable, les
parties du corps humain, les objets familiers ! Mais ils n’avaient pas la
moindre idée de sa structure, […] ils n’avaient jamais songé à
appliquer au langage … qu’ils parlaient dès l’enfance, les procédés d’analyse
qu’ils sont habitués à appliquer à la langue française. […] Les
maîtres ne les y avaient point invités. […] D’où vient ce
délaissement ? Puisque ces enfants parlent deux langues, pourquoi ne pas
leur apprendre à les comparer et à se rendre compte de l’une et de
l’autre ? Ce qui est vrai du basque est vrai du breton. […] Cela
est plus vrai encore et plus frappant pour nos langues méridionales ! Ce
sont, comme le français, des langues d’origine latine. […] Sans
étudier le latin, les enfants verraient apparaître sous la langue française et
sous celle du Midi, et dans la lumière même de la comparaison, le fonds commun
de latinité.[…] J’ai été frappé de voir, au cours de mon voyage à
travers les pays latins, que, en combinant le français et le languedocien, et
par une certaine habitude des analogies, je comprenais en très peu de jours le
portugais et l’espagnol.[…] Si, par la comparaison du français et
du languedocien, ou du provençal, les enfants du peuple, dans tout le Midi de
la France, apprenaient à retrouver le même mot sous deux formes un peu
différentes, ils auraient bientôt en main la clef qui leur ouvrirait, sans
grands efforts, l’italien, le catalan, l’espagnol, le portugais. »
Précurseur, Jaurès met en perspective un
enseignement bilingue français-langue régionale, qu’il considère comme une
ressource pour l’apprentissage des langues et pour l’ouverture au monde. Il
faudra attendre 1951 et la loi Deixonne pour assister aux premiers
balbutiements législatifs d’un enseignement des langues régionales (7).
Le français et le corse, une histoire
singulière
La Corse n’a pas vécu la montée en
puissance de la monarchie absolue depuis la fin du XVIe siècle,
et les conséquences de son acte fondateur, l’ordonnance de Villers-Cotterêts,
qui officialise le français. De la fin du XIIesiècle au début du
XVIIIe siècle, l’île est occupée par Gênes. Le toscan, devenu
au fil du temps l’italien officiel, est alors la langue écrite des occupants et
des élites corses. De son côté, le corse constitue le socle linguistique de la
société agro-pastorale insulaire.
En 1769, après la défaite de la Corse
indépendante de Pascal Paoli et l’annexion de l’île par la France monarchique,
la Corse est rattrapée par l’histoire de France et son Etat centralisé.
Toutefois, le français, que les Corses ignorent généralement, ne peut être
imposé comme langue officielle unique.
Jusqu’à la veille de la Révolution
française de 1789, le Code corse, qui renferme les documents relatifs à la vie
publique publiés dans l’île, continue à être traduit en français et en italien.
Les autorités administratives et judiciaires, les administrés et les
justiciables peuvent utiliser les deux langues. Le 20 juillet 1794, un décret
de la Convention nationale précise que « nul acte public ne
pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu’en
langue française ». En Corse, le décret est suspendu jusqu’en
1806. Il faut attendre 1852 pour que l’italien disparaisse dans les
actes de l’état civil, plus lentement dans les actes notariés.
L’italien définitivement écarté, la
francisation se poursuit avec pour objectif d’effacer également le corse
populaire. Elle s’appuie à la fois sur l’instruction publique obligatoire et la
prohibition de l’usage du corse dans le cadre scolaire. Comme d’autres langues
régionales qui subissent le même sort, le corse résiste. Selon une enquête
statistique de 1864, la Corse « se trouve en compagnie de quatre
départements occitans, dans le groupe où le pourcentage de la population ne
parlant pas le français est le plus élevé : plus de 90 % ». (8)
En 1896, la publication du premier journal
en corse (9) marque un tournant. Ce passage à l’écrit permet au corse de
s’affirmer comme langue à part entière. En 1915, le premier dictionnaire de la
langue corse est publié. Le corse écrit se diffuse au travers de journaux, de
revues, de recueils de poésie... La guerre 39-45 et certains ralliements à
l’irrédentisme du fascisme italien vont marginaliser la revendication
linguistique pendant des années. Aucune protestation ne s’élève lorsque le
corse est écarté du champ d’application de la loi Deixonne en 1951.
Fin des années 1950, des revendications
pour un enseignement du corse se font à nouveau entendre. Puis le « riacquistu » ancre
la revendication linguistique dans un projet de société fondée sur l’existence
du peuple corse. Il enregistre un succès symbolique, avec l’intégration du
corse dans la loi Deixonne. Il ouvre la voie à d’autres mobilisations et à
d’autres succès.
Sortir du désordre linguistique
Aujourd’hui, la situation est paradoxale.
Le corse a fait son entrée dans des domaines où il était exclu : création,
enseignement, médias… Mais son usage quotidien continue à diminuer (10).
De son côté, l’Etat semble vouloir
s’engager dans une politique volontariste de promotion du corse. Il va jusqu’à
tolérer une certaine officialisation de la langue corse, en acceptant son usage
dans des collectivités territoriales. En fait, confronté depuis plusieurs
décennies aux mobilisations de la société corse et à des sollicitations
européennes, l’Etat s’adapte sans autre vision que celle d’un modèle
républicain fondé sur le monolinguisme et concevant la liberté d’expression
comme un exercice individuel. Pourtant, la liberté d’expression s’exerce aussi
au sein de groupes.
Le corse est en danger. L’urgence est
d’abattre le mur de l’uni-cité et d’ériger un nouveau droit linguistique en
lieu et place d’une politique bricolée, opportuniste, contingente, aléatoire.
Désormais, le temps est venu de construire une société bilingue. Il revient à
l’Etat, dans un dialogue avec la Corse, de définir les conditions qui
permettent l’exercice de la liberté d’expression en corse dans tous les
domaines de la vie sociale insulaire. Y compris au sein des collectivités
territoriales de la République et plus largement dans le cadre d’un processus
d’officialisation, tout en garantissant l’accès aux droits pour tous.
Il y a vingt-cinq ans déjà, le rapport
explicatif de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires
rappelait cette exigence démocratique d’un exercice desdites langues dans toute
la société, enseignement, médias, monde judiciaire et administratif, vie
économique et sociale, secteur culturel, pour compenser les conditions
défavorables qui leur ont été réservées dans le passé et pour leur donner la
possibilité de se maintenir, de se développer (11).
(1) En français, la
« réacquisition ». Important mouvement social de réappropriation de
la culture et de la langue corse (création de chants et de groupes
polyphoniques, de pièces et de troupes de théâtre, multiplication de
publications, universités d’été pour la réouverture de l’université de Corse…).
(2) Unesco, Atlas des langues en
danger dans le monde, 2009.
(3) Conseil Constitutionnel, DC du 15 juin
1999.
(4) Norbert Rouland, L’Etat
français et le pluralisme, histoire politique des institutions publiques de 476
à 1792, Odile Jacob, 1995.
(5) « Le 22 mai dernier, les
députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité
nationale. Ils ont souhaité que soit ajoutée dans la Constitution :
‘Les langues régionales appartiennent à son patrimoine’. […] L’Académie française […] demande
le retrait de ce texte […] qui n’a pas sa place dans la
Constitution », extraits de la déclaration du 12 juin 2008.
(6) Revue de l’Enseignement
primaire du 15 octobre 1911.
(7) Tout enseignant du primaire peut se
référer à la langue locale, dans le cadre d'un enseignement facultatif.
(8) Pascal Marchetti, La
Corsophonie, un idiome à la mer, Ed. Albatros, 1989.
(9) Le journal A tramuntana, fondé
par Santu Casanova et destiné à un large public.
(10) Pour exemple, entre 1915 et 1919, son
« taux de transmission » comme « langue habituelle » aux enfants de 5 ans était
de près de 85 % ; entre 1985 et 1986, il est sous les 10 % (Population &
Sociétés, 2002).
(11) Rapport explicatif de la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires, 1992, paragraphe 10
(https://rm.coe.int/16800cb620).
MANIFESTE
POUR LES TEMPS D’AVENIR *