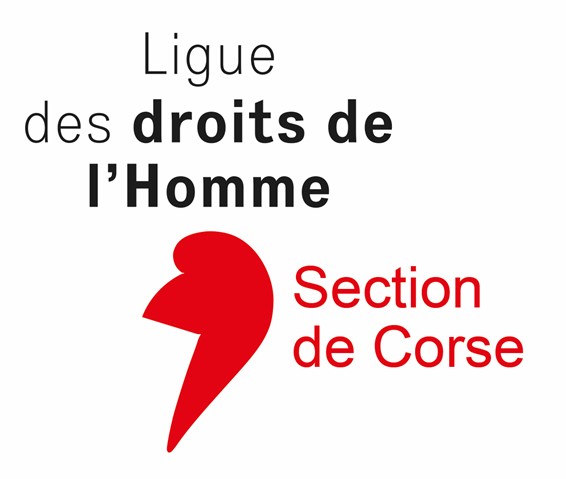Confiance dans l’institution judiciaire : Appel à refonder le pacte républicain pour la justice
Dans ces temps exceptionnels que vit notre pays depuis le déclenchement de la
crise sanitaire qui inévitablement accroît les tensions et les peurs sociales
et économiques, mais aussi dans ces temps plus ordinaires qui précèdent chaque
élection, reviennent avec force les mêmes polémiques voire les mêmes outrances,
les mêmes accusations dirigées contre l’autorité judiciaire soupçonnée de
faiblesses coupables dans la lutte contre l’insécurité et la criminalité.
Et pourtant, la Conférence nationale des premiers présidents en atteste, les
juges vivent dans la cité, sont confrontés chaque jour aux souffrances
des victimes et connaissent les dommages parfois irréparables occasionnés
par la criminalité. Les juges ne sont pas dans leur tour d’ivoire. Ils
travaillent au quotidien avec tous les acteurs de l’action pénale, au premier
rang desquels les membres des forces de sécurité intérieure dont ils mesurent
l’engagement et la difficulté des missions exercées trop souvent au péril de
leur vie.
Les juges appliquent la loi qui leur assigne notamment la mission
d’individualiser les peines en fonction de la gravité des faits et de la
personnalité de l’auteur et de contribuer à prévenir la récidive.
Dans ces temps, la justice est présentée tour à tour :
· comme trop sévère quand les prisons débordent
et les détenus dorment sur des matelas au sol, alors que le parc immobilier
pénitentiaire souvent vétuste n’offre pas les capacités suffisantes pour
procurer à chaque détenu une cellule individuelle, une prise en charge
médico-sociale et un travail ou un enseignement ;
· comme trop laxiste lorsqu’une peine prononcée,
y compris par une cour d’assises – rappelons-le, composée majoritairement de
citoyens jurés – n’est pas à la hauteur de l’émotion et du ressenti des
victimes, pour légitimes et respectables fussent-ils ;
· comme irresponsable pour n’avoir pas deviné ou
su prévenir avec une obligation de résultat la commission d’un crime ou d’un
délit, qu’il ait été commis par un conjoint dans la sphère familiale ou par un
parfait inconnu rencontré « au mauvais moment et au mauvais
endroit » ;
· comme trop lente, lorsque les capacités
d’audiencement, pourtant totalement dépendantes du nombre de dossiers, de juges
et de greffiers, ne permettent pas de juger dans des délais raisonnables les
affaires pénales ou civiles dont elle est saisie.
Les juges sont habitués à être présentés comme les boucs émissaires d’une délinquance
qu’aucune société n’a jamais réussi à éradiquer.
Les juges sont habitués à ce que des lois nouvelles, toujours plus nombreuses,
soient conçues sur un mode incantatoire, en réponse à tout nouveau fait divers,
plutôt que préparées avec l’expertise des professionnels concernés et dans
l’arbitrage nécessaire entre la complexification croissante de la procédure
exigée par la protection légitime des droits humains et les attentes fortes de
la société en matière de lutte contre la délinquance et d’efficacité des
enquêtes.
Les juges sont habitués à appliquer des réformes qui se sédimentent sans
cohérence avec les précédentes et sans que leur soient alloués au préalable les
moyens de leur application dans un contexte d’insuffisance structurelle des
moyens humains et financiers de l’autorité judiciaire.
Les juges, animés de leur seule conscience professionnelle, pourraient une fois
de plus, se résigner, continuer à œuvrer au quotidien avec abnégation, attendre
que les orages passent et que meurent les polémiques du jour pour faire face à
celles qui ne manqueront pas de renaître demain.
Et pourtant ils ne le veulent plus.
La Conférence nationale des premiers présidents souligne que ceux qui
souhaitent aujourd’hui modifier et durcir le calcul des crédits de réduction de
peines des personnes condamnées avec pour effet inévitable l’augmentation de la
population carcérale sont ceux qui ont décidé, par ordonnances prises dans le
cadre de la loi d’urgence sanitaire, de permettre en 2020 la libération de
milliers de condamnés avant leur fin de peine et ont maintenu l’entrée en
vigueur, en mars 2020, en plein confinement, de la loi dite « bloc
peines » accompagnée d’injonctions réitérées et culpabilisatrices aux
magistrats, les mois suivants, de faire baisser encore le nombre de personnes
détenues.
La Conférence constate qu’en mars 2020, la justice n’a pas été considérée
comme une activité vitale ou essentielle pour la nation et que ses personnels,
dépourvus comme tous les Français de masques et de moyens de protection individuelle
ou collective, ont été sommés de travailler à domicile sans les équipements ni
les applicatifs informatiques leur permettant de le faire.
La Conférence répète que les stocks en souffrance d’affaires civiles et pénales
ne sont pas nés de la crise sanitaire mais du profond dénuement humain et
matériel dans lequel a été délaissée, depuis trop longtemps, l’autorité
judiciaire confrontée à une demande de justice toujours plus forte.
La Conférence rappelle inlassablement que toute décision d’un juge s’inscrit
dans le respect de la présomption d’innocence et des règles sur la charge de la
preuve et dans la nécessaire interprétation des lois perfectibles,
contradictoires ou silencieuses comme en matière d’irresponsabilité pénale.
La Conférence attire l’attention de ceux qui se sont indignés de décisions
d’acquittement partiel d’une cour d’assises saisie de faits d’une
exceptionnelle gravité dont ont été victimes des policiers que le projet de loi
qui prétend restaurer « la confiance dans l’institution judiciaire »
imposera une majorité qualifiée de sept voix sur neuf pour déclarer coupable un
accusé et permettra la présence, faute de juges en nombre suffisant, d’avocats
honoraires dans les formations de jugement criminelles.
La Conférence s’inquiète des accusations réitérées selon lesquelles, sur le
plan disciplinaire, la magistrature protégerait impunément ses membres alors
que le Conseil supérieur de la Magistrature, composé, fait unique dans toute la
fonction publique, d’une majorité de membres non-magistrats, veille
légitimement à la transparence exemplaire des sanctions prononcées
régulièrement à l’encontre de ceux qui manquent à leurs obligations
déontologiques.
La justice a un besoin impérieux de ne plus être l’otage de joutes électorales
et de quitter ce théâtre incessant de polémiques, d’accusations et
d’incompréhensions.
Il est temps de mettre fin à ces cycles mortifères de communications et
d’imprécations qui fragilisent non seulement l’autorité judiciaire, mais
surtout la confiance des citoyens dans l’Etat et le « vivre
ensemble ».
Il est donc temps de dire : ça suffit !
Naturellement, l’autorité judiciaire doit continuer à se moderniser, à
s’interroger sur ses pratiques et l’utilisation des moyens, même chichement
mesurés, qui lui sont donnés.
Elle doit aussi dialoguer avec le corps social sous une forme inédite.
C’est pourquoi, la Conférence nationale des premiers présidents en appelle
solennellement à l’organisation dans les mois prochains « d’assises de la
justice pénale », auxquels seront appelés à participer tous ceux,
parlementaires, élus, policiers, gendarmes, avocats, journalistes,
représentants d’associations, désireux d’un dialogue sincère, serein et
constructif avec les magistrats et fonctionnaires de justice, avec l’ambition
commune de refonder le pacte républicain de la justice.
Sans attendre, la Conférence nationale des premiers présidents en appelle à
l’organisation, dans chaque juridiction, de conseils de juridiction élargis
consacrés à la justice pénale et à la qualité de la prise en charge des
victimes, dans la même ambition de renforcer localement les liens nécessaires à
cette refondation.
C’est seulement à ce prix que sera confortée la confiance de chacun dans la
justice et donc dans la démocratie.
Pour la Conférence des premiers présidents de cour d’appel
Jacques Boulard, président de la Conférence